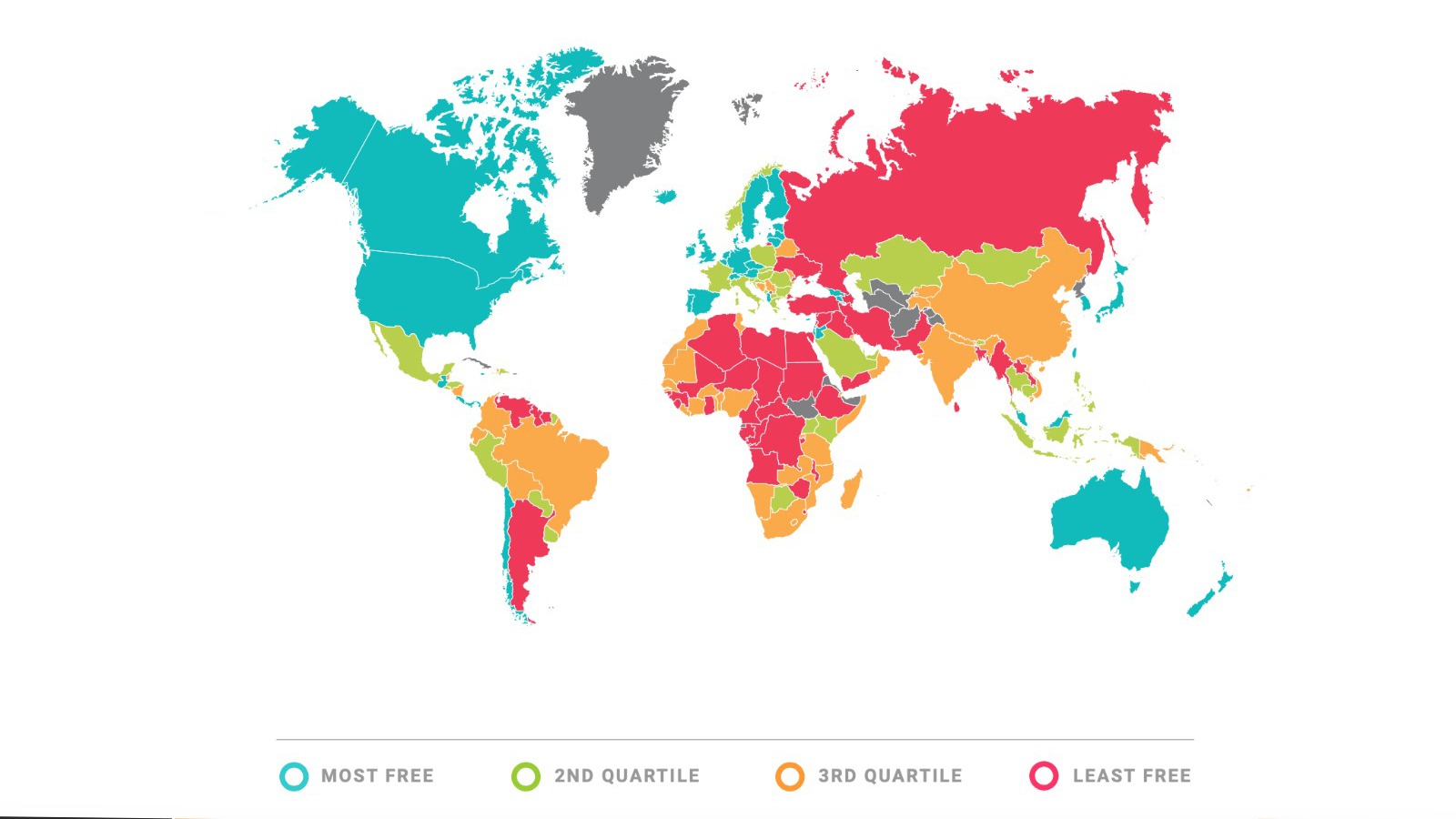Selon le FMI, la réforme des dépenses publiques n’est plus une option technique, mais un impératif de résilience économique pour le continent. Ainsi, dans son dernier rapport périodique intitulé Fiscal Monitor d’octobre 2025, le FMI sonne l’alarme: la dette publique mondiale dépassera 100% du PIB d’ici 2029, un niveau inédit depuis 1948. Pour l’Afrique, malgré des ratios d’endettement souvent inférieurs à 60% du PIB, le rapport plaide pour une refonte urgente des dépenses publiques.
Dans le cadre de cet article, nous avons fait un focus sur 20 économies* clés dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, et l’Afrique du Sud.
Malgré une diversité de situations fiscales, ces pays partagent des défis communs liés à la rigidité des dépenses, inefficacités structurelles et pressions accrues liées aux taux d’intérêt. Pour ces pays, le FMI révèle des pistes concrètes pour transformer la dépense publique en levier de croissance, sans alourdir la fiscalité.
Ainsi, le Fiscal Monitor est sans équivoque, face à une dette mondiale galopante et des taux en hausse, les pays africains gagneraient à prioriser l’efficience sur l’austérité. Le Maroc, avec sa dette maîtrisée et des recettes robustes (30,67% du PIB), pourrait montrer la voie en réallouant ses dépenses vers l’éducation. À l’inverse, le Sénégal ou le Togo devront corriger d’urgence leur trajectoire de dette via des revues de dépenses et une lutte renforcée contre les gaspillages.
C’est le lieu de souligner que dans ce rapport, le FMI rapporte systématiquement les principaux agrégats économiques au PIB, notamment 8 agrégats fiscaux (dette brute, solde budgétaire, déficit, les recettes et dépenses), en les exprimant en % du PIB. L’objectif étant de faciliter les comparaisons entre pays. Ainsi, dans ce qui suit, l’ensemble des taux sont calculés par rapport au PIB.
Au Bénin, la consolidation des programmes de distribution ciblée d'aides sociales réduit les doublons et le gaspillage.. DR
Vulnérabilités et inefficacités persistantes
Selon le FMI, la trajectoire de la dette et des déficits révèle des situations préoccupantes, comme le Sénégal, dont la dette explosive atteint 122,95% du PIB malgré un excédent primaire, illustrant les risques liés à un financement d’infrastructures ambitieuses. À l’inverse, l’Égypte affiche un déficit élevé de -12,36% mais un solde primaire positif de +2,46%, signe d’un poids insoutenable des charges d’intérêts qui grève le budget.
Le Maroc, avec une dette à 67,21% et un déficit à -3,8%, fait preuve d’une relative discipline, mais ses dépenses courantes représentant 34,47% du PIB indiquent des pressions persistantes.
L’Algérie, pour sa part, présente un déficit alarmant de -11,54% du PIB, le plus élevé des 20 pays analysés après l’Egypte (-12,36), soulignant l’urgence de rationaliser les dépenses courantes.
Dans ce contexte, le FMI met en garde contre une aggravation potentielle, notant que «la distribution des risques est large et inclinée vers une accumulation de dette encore plus rapide. Avec 5% de risque, la dette atteindrait 124% en 2029».
Une fragilité exacerbée par une insuffisance chronique des recettes et des rigidités budgétaires. Plus de 70% des pays en développement, comme le Nigeria (9,57% du PIB) et l’Éthiopie (10,46%), ont un ratio recettes/PIB inférieur au seuil critique de 15% identifié par le FMI pour un décollage de la croissance.
Au niveau continental, les dépenses présentent une rigidité structurelle, avec des masses salariales publiques absorbant en moyenne 28% des dépenses totales en Afrique subsaharienne. Des masses salariales caractérisées par des primes de 10% à 13% par rapport au secteur privé, ce qui fausse le marché du travail en restreignant l’offre de main-d’œuvre disponible pour les entreprises privées.
Le cœur du problème réside dans l’inefficacité profonde des dépenses publiques. Le rapport souligne que «les gaps d’efficacité atteignent 39% dans les pays à faible revenu, 34% dans les marchés émergents. Ce qui signifie que les pays pourraient obtenir 30 à 40% de valeur en plus en adoptant les pratiques des meilleurs performeurs».
Lire aussi : Le nouveau cap de la Banque mondiale: mesurer l’impact sur l’emploi, preuves à l’appui dans ces 5 pays d’Afrique
Une inefficacité particulièrement prononcée dans les investissements publics, dont la part dans les dépenses totales n’est que de 11% dans les économies avancées et est en baisse constante depuis 1995, reflétant un sous-investissement chronique et des processus de sélection et de gestion de projets défaillants.
Leviers d’action: réallocation et efficacité technique
Face à ce constat, le FMI identifie des leviers d’action concrets, axés sur une réallocation stratégique des ressources et un renforcement de l’efficacité technique. Une réallocation stratégique qui offre un impact immédiat et substantiel. Le FMI préconise de rediriger ne serait-ce que 1% des dépenses de consommation courante, comme les frais administratifs, vers des secteurs productifs. Une telle réorientation vers l’éducation pourrait générer un gain de PIB de 6% d’ici 2050 dans les pays émergents, tandis qu’un report similaire vers les infrastructures se traduirait par une hausse de 3,5%.
Le Rwanda illustre parfaitement ce potentiel, ayant accru l’efficacité de ses dépenses éducatives de 8 points de pourcentage après des réformes ciblées combinant numérisation et amélioration de l’accès scolaire.
L’exploitation des complémentarités stratégiques est également cruciale. Si les pays avancés maximisent leurs gains en combinant la R&D et le capital humain, les pays africains tireraient un bénéfice optimal à coupler les investissements en infrastructures, qui portent leurs fruits à court terme, avec ceux en éducation, aux effets plus longs mais profonds. Le Sénégal, où la part de l’investissement public dans les dépenses totales est passée de 12% à 19% entre 2019 et 2024, incarne cette approche.
Lire aussi : Discipline budgétaire en Afrique: les pays qui inquiètent le FMI et les autres
Cependant, ces réallocations ne produiront leurs pleins effets qu’accompagnées d’un renforcement institutionnel drastique pour corriger les inefficacités à la source. Le rapport estime sans équivoque que «combattre la corruption et améliorer la transparence réduit le gaspillage», quantifiant cet impact en précisant qu’«une hausse d’un écart-type du contrôle de la corruption améliore l’efficacité des dépenses éducatives de 3,5 points».
Parmi les outils clés, figurent les revues de dépenses qui ont permis à la Slovaquie, à titre d’exemple, d’identifier des économies représentant 7% de ses dépenses, et l’amélioration de la gestion des investissements publics, grâce à laquelle le Togo a réduit son gap d’efficacité de 5 points via une planification pluriannuelle rigoureuse.
Les priorités absolues sont la transparence des marchés publics– un secteur où le gaspillage moyen est estimé à 1,4% du PIB– et une décentralisation accrue pour mieux aligner les dépenses sur les besoins et préférences locales, améliorant ainsi la pertinence et l’impact des services publics.
Implications pour les acteurs économiques
Les conclusions du Fiscal Monitor dessinent un paysage de risques et d’opportunités distincts pour chaque acteur économique. Pour les gouvernements, l’inaction présente des risques aigus. Les pays comme le Sénégal, l’Égypte ou la Tunisie, avec des dettes dépassant 80 % du PIB, voient leur stabilité financière directement menacée si les taux d’intérêt globaux persistent à un niveau élevé, alourdissant mécaniquement le service de la dette.
Lire aussi : Mauritanie et Algérie: le diagnostic du FMI sur les trajectoires économiques
Cela dit, le FMI met en garde contre la tentation de solutions simplistes, affirmant que «les réductions de dépenses généralisées perturbent les services essentiels et compromettent la croissance». C’est d’ailleurs le cas pour l’Algérie qui pourrait être tenté de procéder ainsi. Le FMI recommande au pays une correction budgétaire progressive équivalente à 5% du PIB sur quatre ans (2025-2028), chiffrée à environ 14 milliards USD, pour stabiliser ses finances publiques. A cela s’ajoute le fait que l’institution souligne la nécessité de réformer les subventions énergétiques, élargir l’assiette fiscale hors hydrocarbures, et gérer avec discipline les entreprises publiques, dans un contexte où la croissance algérienne ralentit en 2025 (3,3-3,6%) et les déficits budgétaire et extérieur restent préoccupants, avec une pression sur les réserves et un compte courant en déficit.
À l’inverse, des pays comme le Maroc ou la Côte d’Ivoire, avec une dette inférieure à 60% du PIB, disposent d’une marge de manœuvre stratégique pour investir dans des réformes d’efficience, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, et ainsi construire une croissance plus robuste.
Pour le secteur privé, le rapport souligne des opportunités de complémentarité et de cofinancement. L’implication du privé est présentée comme un levier d’efficacité, le FMI notant que «le secteur privé peut améliorer l’efficacité en externalisant des fonctions non essentielles (transport, maintenance)». Les partenariats public-privé (PPP), comme ceux mis en œuvre au Royaume-Uni, sont identifiés comme un moyen de catalyser l’investissement privé dans les infrastructures, à condition que les risques fiscaux qu’ils génèrent soient rigoureusement maîtrisés. Pour les économies les plus avancées du continent, comme l’Afrique du Sud, la recommandation est de coupler les dépenses en R&D et en éducation afin de maximiser les gains de productivité à long terme.
Enfin, pour les citoyens et les investisseurs, les enjeux se cristallisent autour de l’équité et de la confiance. Un meilleur ciblage des aides sociales, par exemple en rationalisant les programmes fragmentés au Bénin ou au Niger, est essentiel pour libérer des ressources et renforcer l’équité sans alourdir la dépense totale. La confiance, cette ressource intangible, est directement liée à la qualité de la gouvernance. Le FMI rappelle que «renforcer la transparence est essentiel pour que l’argent public procure des avantages durables». Ainsi, les réformes de transparence budgétaire et de lutte contre la corruption ne sont pas seulement des impératifs techniques, mais les fondations mêmes de la légitimité de l’action publique et de l’attractivité d’un pays pour les investisseurs à long terme.
Feuille de route: priorités par typologie de pays
Ainsi, le rapport du FMI implique une différenciation stratégique des réformes en fonction des situations nationales. Pour les pays en crise de liquidité ou de soutenabilité, comme l’Égypte et la Tunisie, l’objectif immédiat est une rationalisation des dépenses courantes. Cela passe par la réforme des subventions, notamment énergétiques, et leur remplacement par un ciblage rigoureux des aides sociales. Le FMI souligne que cette approche est non seulement efficiente mais aussi équitable, précisant qu’un meilleur ciblage des programmes d’assistance sociale peut atténuer les pressions fiscales en redirigeant les ressources vers les plus vulnérables tout en réalisant des économies budgétaires significatives.
Lire aussi : Sésame d’accès à la CAN 2025. Passeport biométrique: où en sont les pays africains?
Les pays disposant d’une marge de manœuvre fiscale, comme le Maroc et l’Afrique du Sud, ont une responsabilité différente. Le Maroc, qui affiche un ratio recettes/PIB de 30,67%, gagnerait à prioriser l’optimisation de sa masse salariale publique, un poste qui pèse en moyenne 22% des dépenses dans la région et représente une source majeure de rigidité budgétaire. Pour l’Afrique du Sud, dont les recettes sont également substantielles (27,65 % du PIB), la priorité est une réallocation ambitieuse vers les infrastructures, un investissement dont le FMI garantit les retours, avec un gain potentiel de 1,5% du PIB à long terme pour une augmentation de 1% du PIB dans ce secteur.
L’Algérie, avec des recettes encore plus faibles (24,08% PIB) et un déficit explosif (-11,54%), gagnerait, pour sa part, à amorcer une réforme urgente des subventions et un ciblage accru des dépenses d’investissement.
Enfin, les pays fragiles ou à faible capacité institutionnelle, comme le Togo et le Niger, gagneraient à se concentrer sur des réformes fondamentales de gouvernance. Le Togo a démontré la voie en réduisant son écart d’efficacité des investissements de 5 points depuis 2015 grâce à une réforme de ses marchés publics et de sa gestion des investissements. Le Niger, quant à lui, pourrait obtenir des gains rapides en digitalisant les paiements des salaires et des aides sociales, une mesure simple mais puissante pour éliminer les «travailleurs fantômes» et les doublons dans les registres sociaux, libérant ainsi des ressources précieuses pour un développement urgent.
Lire aussi : Tunisie: la ville de Gabès en grève générale contre une usine polluante
Ainsi, pour l’Afrique, les marges de manœuvre existent: réallocation vers l’éducation/infrastructures, gains d’efficacité via le numérique, et institutionnalisation des revues des dépenses. Sans ces réformes, la soutenabilité financière restera un mirage, avec des conséquences directes sur la croissance inclusive et la stabilité sociale. A la clé, le FMI annonce une croissance inclusive, une dette soutenable, et une résilience accrue face aux chocs futurs comme récompense.
______
(*) Les 20 économies prises en compte dans cet article sont: Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Afrique du Sud, Nigeria, Gabon, Cameroun, Ethiopie, Rwanda, Kenya, Togo, Bénin, Niger, Tanzanie, et Djibouti.
Cartographie des risques et marges de manœuvre de 20 économies africaines
| Pays | Dette brute (% PIB) | Déficit global (% PIB) | Recettes (% PIB) | Solde primaire (% PIB) | Enjeu spécifique |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 67,21 | -3,80 | 30,67 | -1,25 | Optimisation masse salariale |
| Algérie | 54,05 | -11,54 | 24,08 | -10,51 | Réforme subventions énergétiques, élargir l’assiette fiscale hors hydrocarbures, et gérer avec discipline les entreprises publiques |
| Tunisie | 80,62 | -5,38 | 27,49 | -2,25 | Urgence rationalisation dépenses |
| Libye | N/A | -4,31 | 67,71 | -4,31 | Gestion pétrolière transparente |
| Égypte | 86,97 | -12,36 | 16,60 | +2,46 | Charges d’intérêts insoutenables |
| Mauritanie | 41,20 | -0,46 | 24,92 | +0,39 | Renforcement recettes non minières |
| Côte d’Ivoire | 55,60 | -3,01 | 17,42 | -0,24 | Investissement éducation |
| Sénégal | 122,95 | -7,93 | 21,82 | -2,99 | Dette explosive : revue PPP |
| Afrique du Sud | 77,34 | -5,99 | 27,65 | -0,71 | Réallocation vers infrastructures |
| Nigeria | 36,38 | -2,93 | 9,57 | -0,31 | Recettes trop faibles (<15% PIB) |
| Gabon | 76,22 | -5,41 | 20,36 | -1,97 | Lutte contre corruption |
| Cameroun | 37,92 | -0,84 | 15,04 | +0,39 | Digitalisation services publics |
| Éthiopie | 46,74 | -1,55 | 10,46 | -0,47 | Besoin infrastructures urgentes |
| Rwanda | 73,20 | -6,29 | 21,09 | -3,72 | Modèle réforme éducative |
| Kenya | 68,02 | -5,96 | 17,23 | -0,52 | Contrôle rigidité salariale |
| Togo | 71,85 | -7,58 | 18,81 | -4,95 | Réforme gestion investissements |
| Bénin | 50,74 | -2,90 | 15,57 | -1,02 | Consolidation programmes sociaux |
| Niger | 42,23 | -2,97 | 11,11 | -1,29 | Éradication « travailleurs fantômes » |
| Tanzanie | 49,59 | -2,98 | 16,93 | -0,42 | Complémentarité éducation/infrastructures |
| Djibouti | 30,49 | -1,04 | 19,03 | -0,78 | Développement portuaire efficient |
Source: FMI.