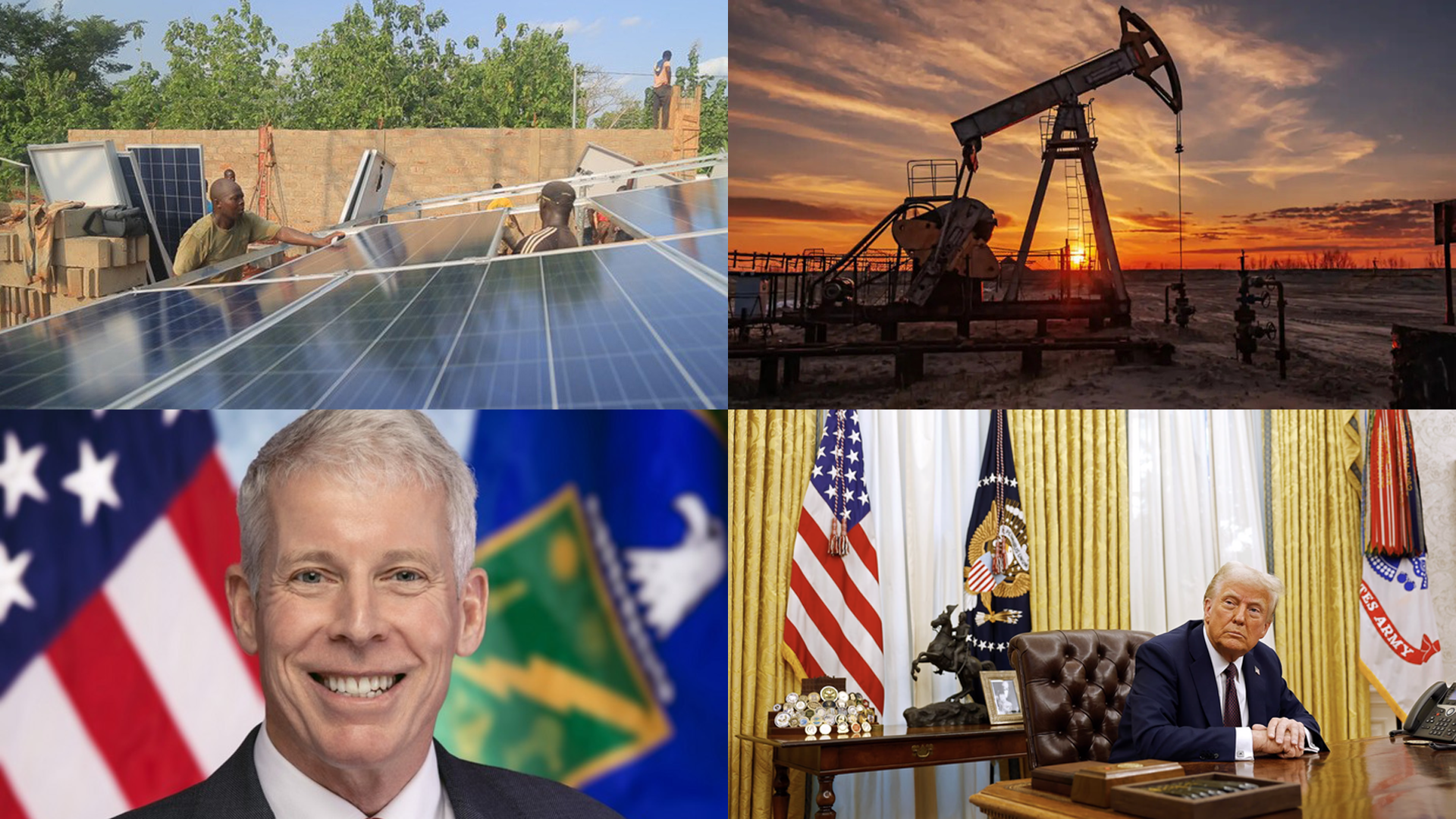Entre dépendance persistante, ambitions de sortie des énergies fossiles et nouvelles opportunités minières, les pays africains naviguent dans un marché mondial du charbon en mutation rapide. Le dernier rapport de la Banque mondiale, Commodity Markets Outlook d’Octobre 2025 et un récent article publié sur son blog dépeignent un tableau intéressant à analyser.
Caractérisé par une demande globalement atone (-1% au premier semestre 2025 en glissement annuel), une offre résiliente malgré des perturbations localisées, et un secteur électrique en transition accélérée, le marché est à la croisée des chemins. Une configuration globale qui a des répercussions profondes pour les poids lourds africains du charbon que sont l’Afrique du Sud, le Maroc, le Mozambique et le Zimbabwe. Zoom sur les enjeux concrets.
La dynamique mondiale est claire: la demande de charbon plafonne, tirée vers le bas par l’expansion des énergies renouvelables, malgré une demande électrique soutenue (véhicules électriques, data centers, climatisation). Les prévisions tablent sur une stabilité globale jusqu’en 2027, masquant des évolutions régionales opposées, notamment un déclin dans l’UE et les États-Unis, et une croissance modérée en Chine et en Inde.
Lire aussi : Charbon: qui sont les deux plus gros consommateurs africains en 2024?
L’offre, dopée au 1er semestre 2025 par la Chine (+6%) et les États-Unis (+8%), devrait se contracter en 2026, avec l’Inde comme seul grand producteur en croissance. Le commerce international s’orienterait aussi légèrement à la baisse. Les prix du charbon australien, après un rebond temporaire au 3ème trimestre 2025 dû aux vagues de chaleur asiatiques et aux perturbations d’approvisionnement (Australie, Indonésie), sont projetés en baisse significative (-21% en 2025, -7% en 2026) avant une légère reprise en 2027. L’analyse des dynamiques africaines révèle quatre trajectoires nationales distinctes, modelées par des héritages énergétiques, des impératifs économiques et des choix géopolitiques divergents.
L’Afrique du Sud incarne le géant aux prises avec ses propres contradictions. En tant que mastodonte incontesté, représentant à elle seule 86% de la consommation continentale et dominant la production avec 234 millions de tonnes en 2024, son économie reste structurellement carbonée. L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) souligne d’ailleurs que «une légère amélioration de l’activité économique et une réduction des délestages ont permis d’accroître la demande de charbon», illustrant le lien organique entre la relance sud-africaine et ce combustible. Une dépendance qui se perpétue par la prolongation de centrales jusqu’en 2030 et une demande électrique si dynamique qu’elle devrait générer un besoin supplémentaire de 14 TWh d’électricité charbon d’ici 2027.
Usine sidérurgique de Mvuma au Zimbabwe. Ce complexe sidérurgique, construit par des entreprises chinoises, est au cœur de la stratégie industrielle du Zimbabwe.
Cette situation offre un horizon de stabilité à court terme aux producteurs miniers et aux opérateurs de centrales, et une énergie domestique relativement abordable pour les industries lourdes. Cependant, elle reporte dans le temps un risque systémique croissant: celui d’actifs échoués pour les uns et d’une exposition accrue au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE pour les autres, tandis que le gouvernement est tiraillé entre la sécurité énergétique immédiate et ses engagements climatiques internationaux.
À l’opposé de cette inertie, le Maroc affiche une volonté politique claire de transition, mais son chemin s’avère complexe. Deuxième consommateur africain avec 9,7 millions de tonnes destinées quasi exclusivement à la production d’électricité, le Royaume a récemment pris l’engagement historique de sortir du charbon d’ici 2040. Pourtant, cette ambition se heurte à une réalité contractuelle contraignante. Comme l’explique Mostafa Labrak‚ directeur général d’Energysium Consulting, «près de 40% de la production électrique dépend encore de contrats privés, fixés jusqu’en 2040», un verrou juridique confirmé par l’expert Amine Bennouna qui identifie là «le principal obstacle».
Ce paradoxe est frappant: le Maroc est simultanément le premier acheteur africain de charbon thermique américain, avec des importations en hausse de 100% au premier semestre 2024 pour répondre aux besoins industriels et contractuels, tout en planifiant son abandon. La stratégie de pont repose donc intégralement sur le gaz naturel, présenté par Labrak comme «la passerelle la plus réaliste» et par Bennouna comme une énergie permettant de remplacer le charbon dans les centrales et l’industrie.
Lire aussi : Transition énergétique: pourquoi la sortie des fossiles est une aubaine pour l’Afrique
Pour les acteurs économiques, cette transition implique pour un producteur comme Taqa Morocco de planifier la reconversion d’actifs sous contrainte, pour les cimenteries de faire de la décarbonation un «levier de compétitivité» face au CBAM, et pour l’État de mobiliser les 40 milliards de dollars estimés nécessaires d’ici 2035 tout en accélérant les réformes structurelles.
Enfin, le Mozambique et le Zimbabwe empruntent une voie radicalement différente, celle d’une opportunité minière et industrielle tournée vers l’exportation et l’industrialisation. En se spécialisant dans le charbon métallurgique (coke) essentiel à la sidérurgie, ces pays deviennent les ateliers émergents du continent, attirant les investissements indiens et chinois. La mine mozambicaine de Benga, détenue par le conglomérat indien SAIL, devrait tripler sa production, tandis que l’aciérie zimbabwéenne de Mvuma, construite par des entreprises chinoises, vise à terme cinq millions de tonnes d’acier par an.
Pour les gouvernements, cet afflux de capitaux et ces projets d’infrastructures portuaires et ferroviaires représentent un puissant vecteur de développement économique et de création d’emplois. Cependant, cette stratégie les expose également à une future dépendance aux cours volatils de l’acier et du charbon métallurgique, ainsi qu’à des risques environnementaux et sociaux accrus pour les communautés locales, sans parler du danger de voir ces nouveaux actifs devenir obsolètes dans un monde qui se décarbone progressivement.
Lire aussi : Les mégaprojets remis en question: comment est réinventée l’exploration pétrolière dans ces six pays africains
La conjoncture mondiale de 2025 impose un réalignement stratégique immédiat et concret pour l’ensemble des acteurs économiques africains liés à la chaîne de valeur du charbon. Pour les producteurs et exportateurs, le nouvel environnement se caractérise par une volatilité accrue et une perspective de déclin structurel à long terme pour le charbon thermique, les contraignant à une optimisation drastique des coûts et à une diversification de leurs débouchés.
L’Afrique du Sud, en particulier, se trouve à un point de rupture: sa dépendance au charbon pour sa production électrique, si elle offre une stabilité de court terme, sape durablement la compétitivité internationale de son industrie face au risque carbone grandissant. Une accélération urgente de sa transition électrique n’est plus une option environnementale, mais un impératif économique.
Pour le Mozambique et le Zimbabwe, la fenêtre d’opportunité offerte par la demande en charbon métallurgique est réelle, mais elle devrait être exploitée avec une vision stratégique qui dépasse l’extraction pure; elle devrait servir de levier pour une industrialisation réelle, tout en préparant dès aujourd’hui l’après-charbon et en gérant de manière proactive les inévitables impacts socio-environnementaux pour éviter de créer de nouvelles vulnérabilités.
Du côté des grands consommateurs électriques, la pression s’intensifie sur trois fronts: financier, avec l’augmentation des taxes intérieures comme au Maroc; réglementaire, sous le poids des engagements climatiques nationaux et des mécanismes extraterritoriaux comme le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE de l’Union européenne; et opérationnel, en raison d’une dépendance aux importations coûteuses et d’une volatilité des prix préjudiciable à la planification. Trois pressions qui rendent la décarbonation du mix électrique non seulement inéluctable mais économiquement impérieuse. Les opérateurs historiques gagneraient désormais à planifier non plus l’exploitation, mais la mutation profonde de leurs actifs charbonniers, en accélérant le virage vers les renouvelables et le gaz de transition.
Au Maroc, cette transformation se heurte de front à la rigidité des contrats d’achat d’électricité de longue durée, qui constituent un frein juridique et financier majeur à une transition accélérée, obligeant à des renégociations complexes.
Une nouvelle donne qui affecte tout aussi profondément les industriels lourds tels que les cimenteries et les aciéries. Pour eux, la compétitivité à l’export, notamment vers le marché européen, est en train de se redéfinir autour d’un nouveau critère central: l’intensité carbone. La recherche d’efficacité énergétique et le passage à des combustibles moins carbonés, principalement le gaz puis, à terme, l’hydrogène vert, ne relèvent plus de la responsabilité sociale d’entreprise mais deviennent une stratégie commerciale vitale.
Ainsi, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE incitera les industries marocaines exportatrices à réduire leur empreinte carbone, transformant ainsi la décarbonation en levier de compétitivité. Une dynamique qui s’applique à toutes les industries exportatrices du continent, faisant de la décarbonation un élément clé de leur survie sur les marchés internationaux.
Enfin, pour les investisseurs et financeurs, le paysage des opportunités et des risques se recompose radicalement. Les projets purement charbonniers, à l’exception notable du charbon métallurgique de haute qualité et des projets miniers intégrés à une chaîne de valeur industrielle locale, voient leur risque s’accroître de manière significative, que ce soit le risque de réputation, le risque réglementaire ou le risque financier lié aux actifs échoués. Le capital se redirige massivement vers les énergies renouvelables, les gains d’efficacité énergétique, les infrastructures gazières de transition et toutes les technologies de décarbonation.
En parallèle, les besoins en financements climatiques concessionnels pour accompagner cette transformation, notamment au Maroc où ils sont estimés à plus de 40 milliards de dollars d’ici 2035, et potentiellement en Afrique du Sud pour une sortie ordonnée du charbon, deviennent colossaux. L’enjeu n’est plus de financer la croissance d’une industrie du passé, mais de sécuriser les capitaux nécessaires pour bâtir l’infrastructure énergétique de l’avenir.
Ainsi, le marché mondial du charbon en 2025 confirme que la transition énergétique est enclenchée, mais qu’elle est profondément inégale. Pour l’Afrique du Sud et le Maroc, consommateurs historiques, la feuille de route est tracée (sortie progressive), mais le chemin est semé d’embûches techniques, financières et juridiques. Le gaz s’impose comme une transition pragmatique, notamment au Maroc.
Le Mozambique et le Zimbabwe, producteurs émergents, naviguent dans une temporalité différente, cherchant à capter les bénéfices économiques immédiats du charbon métallurgique pour leur industrialisation, tout en devant en gérer les externalités négatives. Pour tous les acteurs économiques concernés, la donne a changé: la décarbonation n’est plus seulement une contrainte environnementale, c’est désormais un impératif de compétitivité économique et d’accès aux marchés, particulièrement face au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières européennes.
La capacité des pays et des entreprises à gérer cette complexité, à mobiliser les financements verts et à accélérer les réformes déterminera leur résilience dans l’économie bas-carbone de demain.
Défis et trajectoires de quatre économies clés
| Pays | Statut clé | Défis majeurs | Stratégies/Opportunités | Projections/Engagements |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 1er consommateur (165 Mt, 86% du continent); 1er producteur (234 Mt) | - Dépendance structurelle au charbon; - Risque d’actifs échoués; - Pression du CBAM européen; - Dilemme sécurité énergétique vs climat; | - Prolongation centrales jusqu’en 2030; - Développement nucléaire (+50%) et renouvelables; | Consommation électrique charbon ↗ à 124 Mt d’ici 2027 (+14 TWh); |
| Maroc | 2e consommateur (9,7 Mt); 1er importateur africain de charbon US (+100% en 2024); | - Verrous juridiques (contrats jusqu’en 2044/2045); - Dépendance industrielle; - Financement transition (40 Md$); | - Sortie du charbon d’ici 2040; - Pont gazier (terminal Nador 2026-2027); - Réformes légales (lois 40-19/82-21); | Objectif : 52% renouvelables d’ici 2030; |
| Mozambique | 2e producteur africain; Spécialisation charbon métallurgique; | - Dépendance aux cours mondiaux de l’acier; - Risques socio-environnementaux; - Obsolescence future des actifs; | - Triplement production mine Benga (SAIL); - Infrastructures portuaires/ferroviaires; | ↗ Production charbon liée à l’industrialisation (projets sino-indiens); |
| Zimbabwe | 3e producteur africain; Nouveau pôle sidérurgique; | - Volatilité des marchés; - Impacts locaux des projets miniers; - Financements limités; | - Aciérie de Mvuma (objectif 5 Mt d’acier); - Partenariats chinois; | ↗ Production charbon pour soutenir la sidérurgie (↗ besoins industriels) |
Source: Banque Mondiale; AIE.