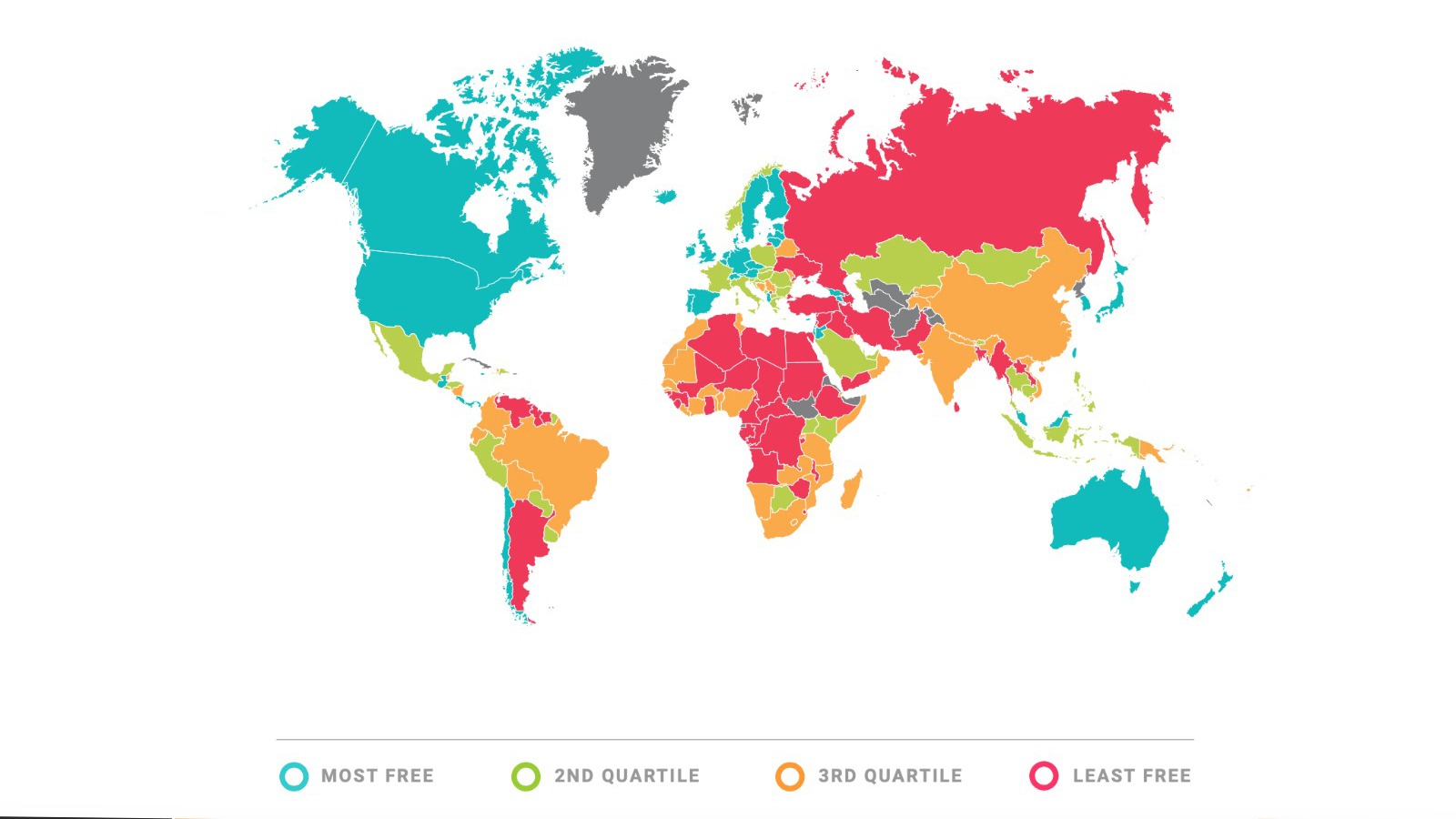Les marchés mondiaux semblent calmes, mais les vulnérabilités s’accentuent, les prix des actifs à risque atteignent des sommets historiques, les dettes publiques croissent et les liens entre les banques et les acteurs non bancaires se renforcent. Des signaux rouges qui pourraient s’amplifier en cas de choc. C’est dans ce contexte que le FMI procède à la publication de son rapport sur la stabilité financière mondiale d’octobre 2025 intitulé: «global Financial stability Report». Un rapport qui met en lumière des trajectoires divergentes au sein des économies émergentes et en développement (EMDEs) à son chapitre 3.
Tandis que les pays dotés de fondamentaux macroéconomiques robustes, comme l’Afrique du Sud, parviennent à émettre massivement en monnaie locale et à mobiliser une base d’investisseurs résidents, d’autres États africains (Ghana, Tunisie, Zambie) demeurent captifs d’un financement en devises étrangères et de sources de capitaux volatiles.
Une fracture qui s’inscrit dans un contexte d’endettement public mondial explosif: la dette des EMDEs a doublé depuis 2010, frôlant les 30.000 milliards de dollars (près de 12.000 milliards hors Chine), accentuant leur vulnérabilité aux chocs externes.
Lire aussi : Le nouveau cap de la Banque mondiale: mesurer l’impact sur l’emploi, preuves à l’appui dans ces 5 pays d’Afrique
Comme le souligne le rapport, «les EMDEs dotés de marchés obligataires en monnaie locale (LCBMs) diversifiés affichent des rendements stables et une liquidité résiliente lors des chocs globaux», confirmant l’avantage stratégique de l’ancrage monétaire local. Ainsi, sur le continent africain, trois groupes de pays apparaissent et autant de réalités.
Afrique du Sud: modèle de résilience
Selon le FMI, l’Afrique du Sud incarne la trajectoire vertueuse des «Major EMs». Sa dette souveraine est structurée à 80% en monnaie locale (rand), avec une maturité moyenne de 7 ans– bien supérieure à celle des marchés frontières (4 ans). Une robustesse qui repose sur une base d’investisseurs domestiques diversifiée, combinant banques et institutions non bancaires (fonds de pension, assureurs), réduisant ainsi l’exposition aux fuites soudaines de capitaux non-résidents. Toutefois, le pays n’est pas à l’abri d’un défi structurel: le coût réel de sa dette (4,5%) grève sa marge budgétaire, flirtant avec le taux de croissance projeté (5%), ce qui pourrait limiter sa capacité de relance en cas de crise.
Le siège du Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis.. IMF
Les pays à risques accrus : Ghana, Tunisie, Zambie
Ce groupe cristallise les vulnérabilités des EMDEs fragiles. Leur dépendance aux devisés étrangères est criante: 38% de leurs émissions y sont libellées (contre 13% pour les «Major EMs»), selon la catégorisation «Other EMs» incluant le Ghana. Faute d’une épargne financière domestique suffisante, ces États recourent massivement aux banques locales et aux bonds du Trésor à court terme, alimentant un «nexus souverain-banque» dangereux. Entendez par «nexus souverain-banque», l’interdépendance entre les banques et les États, liée notamment à la détention par les banques d’une grande quantité de dette souveraine (dette publique).
Le rapport alerte: «l’expansion rapide des marchés obligataires en monnaie locale (LCBMs) sans capacité d’absorption suffisante accroît les risques de répression financière et de contagion bancaire». Les cas extrêmes du Ghana et de la Zambie illustrent ce risque systémique. Leurs restructurations récentes de dette domestique ont infligé des pertes sévères aux banques locales, menaçant la stabilité financière nationale.
Le groupe des marchés frontières : Nigeria, Kenya, Égypte
Ces pays affichent des progrès fragiles. Bien que leur part d’émissions en monnaie locale ait bondi à 63% en 2024 (contre 45% en 2010), ils peinent à allonger les maturités et subissent des coûts réels prohibitifs. Le Nigeria paie ainsi un taux réel de 6,5% pour sa dette domestique, dépassant sa croissance projetée (5,2%), tandis que le Kenya émet des obligations indexées à l’inflation pour compenser la méfiance des investisseurs. Cette dynamique est aggravée par une liquidité précaire: la domination des banques dans la détention de dette souveraine limite la diversification des acheteurs, amplifiant la volatilité des rendements lors des turbulences globales, comme lors du «taper tantrum» de 2013.
Où est le Maroc dans tout ça ?
Le Maroc, à l’instar d’un nombre important de pays africains, ne figure pas explicitement parmi les pays mentionnés dans cette étude du FMI. Cela s’explique par les critères d’analyse utilisés. L’étude se concentre sur les pays avec des marchés obligataires locaux ayant eu des restructurations majeures ces dernières années (Argentine, Ghana, Sri Lanka, etc.). Rappelons aussi que pour le Maroc, la dynamique de dette est moins exposée aux risques mis en avant.
Quelle stratégie adopter ?
La fracture de résilience entre pays africains impose des stratégies différenciées aux acteurs économiques. Pour les gouvernements, les nations stables (Afrique du Sud, Botswana) doivent exploiter leur accès privilégié aux marchés locaux pour émettre des obligations à long terme en monnaie domestique, consolidant ainsi leur autonomie financière. À l’inverse, les pays vulnérables (Ghana, Tunisie, Zambie) doivent prioriser la crédibilité des politiques budgétaires et monétaires pour attirer des investisseurs internationaux stables, réduisant leur dépendance aux financements spéculatifs en devises.
Lire aussi : Gabon. Assainissement des finances publiques: le coup de pied dans la fourmilière
Les investisseurs locaux (banques, fonds de pension) font face à des dynamiques contrastées: en Afrique du Sud, les obligations souveraines longues offrent des rendements prévisibles, tandis qu’au Ghana et en Zambie, les risques de restructuration imposent une diversification urgente hors dette publique pour éviter des pertes systémiques. Quant aux investisseurs internationaux, leur désintérêt persistant pour les marchés obligataires locaux africains (sauf Afrique du Sud), amplifié par la force du dollar et des rendements décevants, les conduit à cibler sélectivement des pays comme le Botswana et la Namibie où la dette locale génère des rendements réels positifs dans un cadre macroéconomique fiable.
Les leçons clés et voies à suivre
Trois impératifs émergent du rapport. Premièrement, la profondeur des marchés reste un atout rare: seuls le Botswana et la Namibie disposent d’investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs) capables d’absorber la dette souveraine sans alimenter le risque systémique. Deuxièmement, des mesures urgentes s’imposent : limiter le «nexus souverain-banque» au Nigeria et au Kenya via des plafonds réglementaires d’exposition bancaire aux titres d’État, et développer les marchés monétaires (notamment les pensions livrées– repo) en Égypte et au Nigeria pour améliorer la liquidité secondaire. Comme le souligne le FMI, «la diversification de la base d’investisseurs résidents est critique pour briser le cercle vicieux dette faible/croissance».
Troisièmement, un risque géopolitique sous-estimé menace l’Algérie et l’Ouganda. En effet, alors qu’ils sont classées Frontier Markets (FM), l’Algérie et l’Ouganda n’apparaissent ni dans le panel des pays transparents sur le coût réel de leur dette ni dans celui des pays transparents sur les indicateurs de maturité. Le FMI note que «les limitations de données empêchent une analyse détaillée». Ainsi, pour ces pays, l’opacité des statistiques publiques et la faible liquidité des marchés obligataires locaux biaisent les évaluations de risque.
Lire aussi : Le Kenya convertit un prêt de 3,5 milliards USD en yuans pour alléger sa dette
L’opacité des données algériennes et ougandaises révèle ainsi des angles morts critiques. Le FMI en déduit que l’absence de données sur les coûts de leurs dettes masque des vulnérabilités, exigeant des réformes préventives pour éviter des chocs futurs.
Ainsi, comme l’on peut le constater, l’Afrique illustre avec acuité la divergence des trajectoires des économies émergentes et en développement. Pendant que l’Afrique du Sud et le Botswana transforment leurs marchés obligataires locaux en remparts contre les chocs globaux, le Ghana et la Zambie paient le prix de décennies de faible crédibilité politique et d’épargne domestique atone. La stabilisation durable passera par trois leviers : des politiques macroprudentielles renforcées au Nigeria et au Kenya pour contenir l’interdépendance banques-État ; une transparence accrue des émissions en Tunisie et Égypte pour restaurer la confiance des investisseurs ; et une coopération régionale pour mutualiser les infrastructures de marchés de capitaux (plateformes de négociation, harmonisation réglementaire). Le constat ultime du FMI reste incontournable : «l’ancrage de la dette en monnaie locale et la diversification des investisseurs restent les piliers de la stabilité financière en Afrique», un mantra qui sépare déjà les résilients des captifs de la vulnérabilité.
Fracture africaine face à la dette: résilients locaux vs captifs des devises
| Pays | Catégorie | Dette en monnaie locale | Maturité moyenne | Risques principaux | Investisseurs dominants |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Major EMs (Résilient) | 80% | 7 ans | Coût réel élevé (4.5%) limitant la marge budgétaire | Banques, fonds de pension, assureurs |
| Botswana | Marché résilient | Données non précisées | Élevée (sup. à 4 ans) | Aucun risque majeur cité | Investisseurs institutionnels (pensions, etc.) |
| Namibie | Marché résilient | Données non précisées | Élevée | Aucun risque majeur cité | Investisseurs institutionnels |
| Ghana | Autres EMs (Vulnérable) | Faible (dépendance forex) | Courte | Restructurations dommageables, risque systémique bancaire | Banques locales, financements volatils |
| Tunisie | Autres EMs (Vulnérable) | Faible | Courte | Dépendance aux devises étrangères, faible crédibilité politique | Sources de capitaux volatiles |
| Zambie | Autres EMs (Vulnérable) | Faible | Courte | Pertes bancaires après restructuration, instabilité financière | Banques locales |
| Nigeria | Marchés frontières | 63% (en hausse) | Courte | Coût réel élevé (6.5%), liquidité précaire, nexus souverain-banque | Banques dominantes |
| Kenya | Marchés frontières | Environ 60% | Courte | Émissions indexées à l’inflation, méfiance des investisseurs | Banques |
| Égypte | Marchés frontières | Environ 60% | Courte | Liquidité faible, besoin de marchés monétaires développés (repo) | Banques |
| Algérie | Marchés frontières (opaque) | Données indisponibles | Inconnue | Opacité statistique, risques géopolitiques sous-estimés | Non spécifié |
| Ouganda | Marchés frontières (opaque) | Données indisponibles | Inconnue | Limitations de données masquant des vulnérabilités, faible liquidité des marchés | Non spécifié |
Source: FMI.