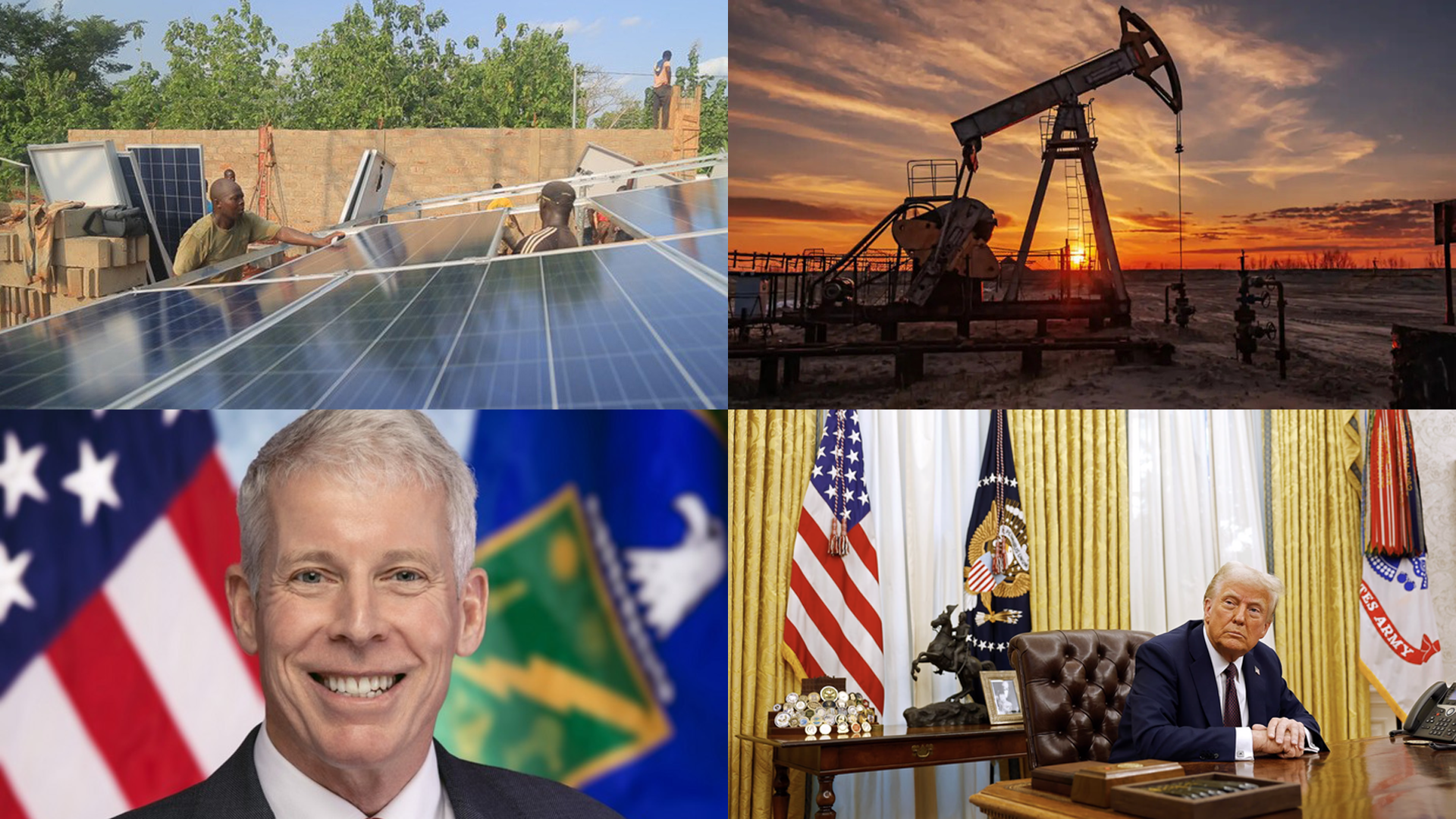La création de la Banque Africaine de l’Énergie (BAE), annoncée lors du Congo Energy&Investment Forum, qui s’est tenu du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville, en République du Congo, marque un tournant stratégique pour l’Afrique. Conçue pour financer des projets pétroliers et gaziers face au désengagement des institutions financières occidentales, cette initiative portée par l’African Petroleum Producers Organization (APPO) et la banque panafricaine Afreximbank révèle autant d’ambitions que de défis. «L’objectif est de bâtir une autonomie financière pour développer ce secteur stratégique pour nos économies et ne plus dépendre des investisseurs occidentaux», souligne Zakaria Dosso, directeur général de l’Africa Energy Investment Corporation, la branche d’investissement de l’APPO.
Le tour de table entre contributeurs, promesses et absents
La BAE structure son financement autour d’une capitalisation initiale cible de 5 milliards de dollars, un montant ambitieux destiné à soutenir des projets énergétiques sur le continent. Sur cette somme, les 18 États membres de l’African Petroleum Producers Organization (APPO) sont appelés à contribuer individuellement. À ce stade, seuls trois pays– le Nigeria, l’Angola et le Ghana– ont honoré leurs engagements, injectant collectivement 249 millions de dollars.
Cinq autres membres– l’Algérie, le Bénin, le Congo, la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire– ont pris des engagements formels: effectuer leurs paiements, conformément à l’objectif de la banque de démarrer ses opérations au premier semestre 2025. Leur adhésion porterait le total à huit membres actifs, mais leur retard pourraient refléter des divergences politiques. Les dix États restants, notamment le Cameroun, le Gabon, la Libye et la RD Congo, l’Égypte, la Namibie, le Niger, le Sénégal, l’Afrique du Sud et le Tchad, n’ont exprimé aucune position publique.
Lire aussi : Lequel de ces 7 pays accueillera le siège de la future Banque africaine de l’énergie
Les 249 millions déjà versés ne représentent que 4,98 % du total visé. Pour combler ce gap, l’APPO devra à la fois presser ses membres– certains confrontés à des crises de liquidités– et séduire des investisseurs privés, peu enclins à s’engager sans garanties de rentabilité dans un marché africain perçu comme risqué. Le calendrier opérationnel, fixé au premier semestre 2025, ajoute une pression supplémentaire, les processus administratifs africains étant souvent ralentis par des lourdeurs bureaucratiques et des instabilités politiques.
Enfin, la crédibilité de la BAE reposera sur sa gouvernance. Les précédents d’institutions similaires, entachées par des scandales de corruption ou des opacités décisionnelles, obligent à une rigueur exemplaire. La définition de critères d’investissement transparents, incluant des audits indépendants et des mécanismes de suivi des projets, sera cruciale pour rassurer partenaires internationaux et opinions publiques. Ces défis, s’ils sont relevés, feront de la BAE un acteur clé de la transition énergétique africaine, dans le cas contraire, ils rappelleront les écueils historiques des initiatives panafricaines.
Les trois contributeurs actifs
Le Nigeria, l’Angola et le Ghana incarnent les piliers fondateurs de la BAE, chacun y projetant des ambitions alignées sur leurs stratégies énergétiques nationales. Le Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne, cherche à sécuriser des financements pour son agenda gazier, essentiel à sa transition énergétique. Des projets structurants comme le développement du champ gazier d’Ubeta (550 millions de dollars) et le mégaprojet pétrolier Bonga North (5 milliards de dollars) dépendent de capitaux complémentaires, malgré les réformes du Petroleum Industry Act visant à attirer les investisseurs. Il faut aussi garder à l’esprit que le siège de la Banque Africaine de l’Énergie (AEB) est situé à Abuja, au Nigeria. Un choix qui a été officialisé en juillet 2024, après une compétition entre plusieurs pays africains, notamment l’Algérie, le Bénin, le Ghana, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.
L’Angola utilise son apport à la BAE comme levier pour diversifier ses partenariats et financer des projets hybrides, à l’image du complexe Kaminho en eaux profondes (6 milliards de dollars) et de son premier projet d’hydrogène vert (600 MW), symboles d’une stratégie équilibrant hydrocarbures et énergies décarbonées.
Le Ghana, bien que moins doté en réserves, mise sur la BAE pour renforcer sa crédibilité auprès d’acteurs comme Eni et Tullow Oil, dont les investissements dans les champs Jubilee et TEN stimulent sa croissance économique. La modernisation de son cadre réglementaire et ses incursions dans les renouvelables illustrent une approche pragmatique, où la BAE sert de catalyseur pour une transition énergétique inclusive. Ces trois pays, par leur engagement financier, ne soutiennent pas seulement la banque, mais y impriment une orientation géoéconomique, favorisant des projets à fort impact régional et reflétant leurs priorités industrielles.
Les promesses en attente
Les engagements non matérialisés pour l’heure de l’Algérie, du Bénin, du Congo, de la Guinée équatoriale et de la Côte d’Ivoire révèlent une mosaïque de contraintes et d’aspirations. L’Algérie, dotée d’importantes réserves gazières mais confrontée à un isolement financier croissant en raison de tensions géopolitiques et d’un déficit d’investissements étrangers, perçoit la BAE comme un outil de réaffirmation régionale.
Le Bénin et la Guinée équatoriale, aux économies plus modestes, illustrent le dilemme des États à faible production pétrolière. Bien que le Bénin ne soit pas un grand producteur de pétrole, son intérêt pour une organisation comme la BAE pourrait être lié à la promotion du développement énergétique et à la solidarité régionale. Rappelons que le Bénin a produit environ 22 millions de barils de pétrole par le passé, principalement à partir du gisement de Sèmè. La production actuelle reste faible, ce qui pousse le pays à intensifier les recherches pour des gisements plus vastes.
Lire aussi : Oléoducs, GNL, solaire: voici les 10 projets énergétiques structurants chinois en Afrique
Pour la Guinée équatoriale, l’adhésion à une organisation comme la BAE pourrait être motivée par la nécessité de renforcer son secteur énergétique, attirer des investissements et promouvoir la coopération régionale. Le pays est un producteur significatif de pétrole en Afrique, bien qu’elle ait connu une baisse récente de sa production. En mars 2023, la production moyenne était de 48.000 barils/jour, bien en dessous de son quota OPEP. Les hydrocarbures représentent une part importante de son PIB et de ses exportations.
Le Congo et la Côte d’Ivoire, producteurs intermédiaires, cherchent quant à eux à renforcer leur influence au sein de l’APPO. Le Congo, en pleine relance de son secteur pétrolier grâce au champ marin de Moho Nord, pourrait y voir un moyen de sécuriser des financements pour ses infrastructures. La Côte d’Ivoire, dont la production gazière augmente, mise sur la BAE pour asseoir son statut de plaque tournante énergétique en Afrique de l’Ouest.
Si elles se concrétisent, ces promesses de contribution dans la BAE refléteront une réelle volonté politique ; dans le cas contraire, elles exposeront les limites d’un modèle de financement dépendant d’États aux ressources volatiles.
Souveraineté énergétique et dilemmes financiers
Il faut dire que la création de la BAE s’inscrit dans un contexte de retrait progressif des financements occidentaux des projets fossiles, une tendance accentuée par les pressions réglementaires et l’activisme climatique. Comme le souligne le Dr Omar Farouk Ibrahim, Secrétaire général de l’APPO, «ce progrès significatif» traduit une quête de souveraineté énergétique, mais il soulève un paradoxe: la dépendance persistante aux contributions étatiques, dans un continent où de nombreux pays (Nigeria, Angola, Congo) consacrent déjà plus de 20 % de leurs budgets au remboursement de la dette. Géopolitiquement, le leadership assumé par le Nigeria et l’Angola renforce leur hégémonie.
Sur le plan environnemental, la BAE navigue dans une zone grise. Si elle promeut des initiatives comme l’hydrogène vert en Angola ou les renouvelables au Ghana, son cœur de métier reste ancré dans les hydrocarbures. Un positionnement qui alimente les critiques des organisations de la société civile. La BAE incarne ainsi le difficile équilibre entre développement urgent des infrastructures énergétiques et impératifs climatiques globaux.
Lire aussi : Partenariats public-privé en Afrique: pourquoi seulement 5 pays concentrent 50 % des projets réussis
Ainsi, la BAE incarne l’ambition d’une Afrique maîtresse de son destin énergétique, mais son succès dépendra de sa capacité à transcender les défis financiers et géopolitiques. Entre urgence climatique et impératif de développement, elle devra concilier financements fossiles et transition verte, sous le regard critique d’une société civile exigeante. Si les promesses se muent en actes, elle pourrait écrire une nouvelle page de la souveraineté africaine. Sinon, elle rejoindra le cortège des projets inachevés. L’échéance de fin juin 2025 sera un premier verdict.
Contributions, retards et enjeux géopolitiques derrière les 5 milliards de dollars de capital de la BAE
| Pays | Statut | Observations |
|---|---|---|
| Nigeria | Contributeur actif | Siège de la BAE à Abuja. Projets phares : champ gazier d’Ubeta (550 M$) et Bonga North (5 Md$). Stratégie gazière et réformes via le Petroleum Industry Act. |
| Angola | Contributeur actif | Finance des projets hybrides (Kaminho, hydrogène vert). Diversification énergétique et recherche de partenariats stratégiques. |
| Ghana | Contributeur actif | Modernisation réglementaire. Dépend des investissements d’Eni et Tullow Oil (champs Jubilee et TEN). Transition inclusive via la BAE. |
| Algérie | Engagement non matérialisé | Enjeu géopolitique : isolation et tensions. Ambition de réaffirmation régionale via le gaz. |
| Bénin | Engagement non matérialisé | Production pétrolière faible (ancien gisement de Sèmè). Intérêt symbolique pour la BAE et solidarité régionale. |
| Congo | Engagement non matérialisé | Relance du secteur pétrolier (Moho Nord). Cherche à sécuriser des financements pour infrastructures. |
| Guinée équatoriale | Engagement non matérialisé | Production en baisse (48 000 barils/jour en 2023). Priorité à la coopération régionale et à l’attraction d’investissements. |
| Côte d’Ivoire | Engagement non matérialisé | Hausse de la production gazière. Aspiration à devenir un hub énergétique en Afrique de l’Ouest. |
| Égypte | Silence | Aucune position publique. Potentiel stratégique dans le gaz méditerranéen. |
| Sénégal | Silence | Projets gaziers offshore (Grand Tortue Ahmeyim). Attentisme lié aux défis politiques et aux partenariats internationaux existants. |
| Afrique du Sud | Silence | Priorité aux énergies renouvelables et au charbon. Réticence possible face à l’accent de la BAE sur les hydrocarbures. |
| Gabon | Silence | Producteur historique. Incertitudes politiques post-transition. |
| Cameroun | Silence | Projets pétroliers en développement (ex. champ Etinde). |
| Libye | Silence | Instabilité politique chronique. Production pétrolière volatile, mais potentiel inexploité. |
| RD Congo | Silence | Enjeux de gouvernance et priorité aux minerais (cuivre, cobalt). Peu d’intérêt affiché pour les hydrocarbures. |
| Namibie | Silence | Découvertes pétrolières récentes (offshore). Prudence face aux engagements internationaux et attente de clarification des cadres légaux. |
| Niger | Silence | Contexte sécuritaire fragile. Production pétrolière modeste, mais en croissance. |
| Tchad | Silence | Dépendance forte au pétrole (60 % des recettes). |
Source : African Petroleum Producers Organization (APPO); Afreximbank.