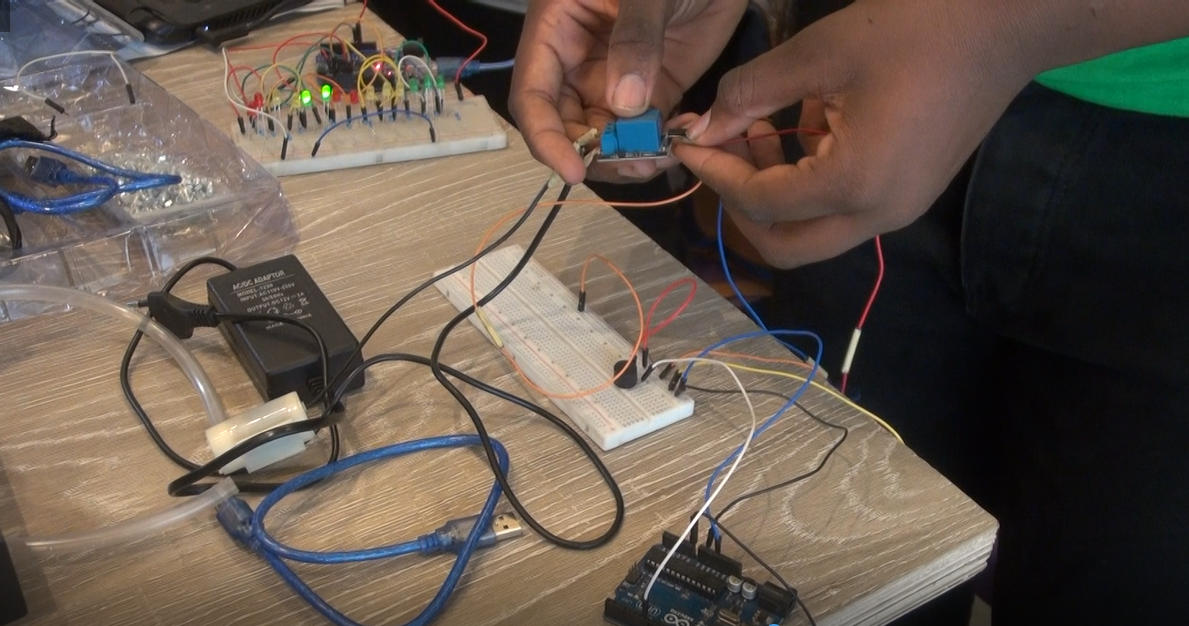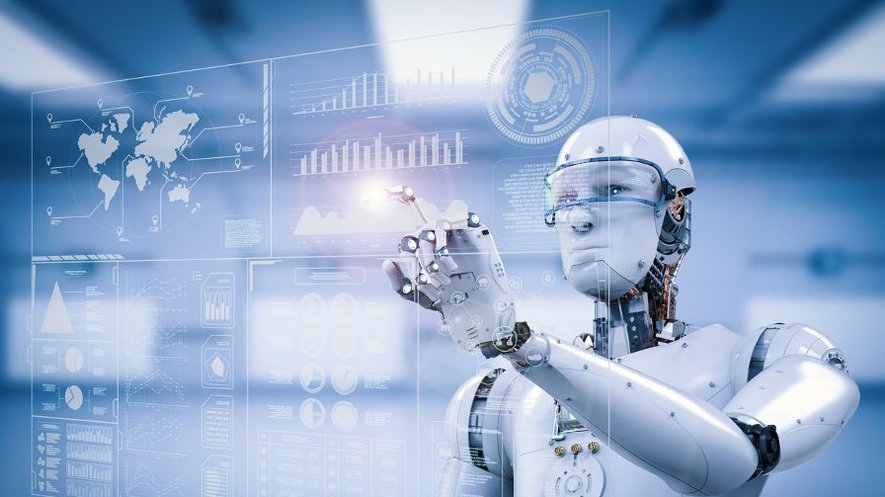Le rachat de X (ex-Twitter) par xAI, la startup d’Elon Musk spécialisée en intelligence artificielle, marque un tournant stratégique aux implications multiples pour les 40 millions d’utilisateurs actifs africains. Entre exploitation massive des données, transformation de l’expérience utilisateur, dépendance technologique et enjeux réglementaires, cette fusion interroge autant qu’elle promet.
Du carburant gratuit pour Grok
Il faut dire que le rachat de X par xAI, le 28 mars, place les données des 40 millions d’utilisateurs africains du réseau social (dont 10 millions au Nigeria et 8 millions en Afrique du Sud) au cœur d’un enjeu stratégique et éthique. Ces données- tweets, interactions, médias- constituent désormais le socle d’entraînement des modèles d’IA comme Grok, conçu pour rivaliser avec ChatGPT. Stéphane Madrange, directeur général de Médiane Système, souligne avec virulence: «Vos tweets, photos, messages… deviennent le carburant des modèles d’IA d’Elon Musk. Pas d’opt-in, pas d’indemnisation».
Lire aussi : Internet: Starlink engage la bataille dans 25 nouveaux pays d’Afrique
Cette exploitation massive, dépourvue de consentement explicite, s’inscrit dans un contexte réglementaire africain fragmenté où seuls 37 pays sur 54 disposent d’une législation complète sur la protection des données, laissant les utilisateurs exposés à des pratiques qui feraient l’objet de sanctions en Europe (RGPD) ou au Canada, où une enquête contre X a été ouverte en février 2025. L’absence de moyens techniques et financiers des régulateurs locaux aggrave cette asymétrie, créant un terreau propice à l’exploitation unilatérale.
Pourtant, X reste un pilier de l’activisme et de l’information en Afrique, comme en témoignent des mouvements tels que #EndSARS au Nigeria, une mobilisation populaire initiée pour dénoncer les abus et violences perpétrés par la Special Anti-Robbery Squad (SARS), une unité spéciale de la police nigériane. Idem pour le mouvement #FeesMustFall en Afrique du Sud, qui lui aussi a utilisé ces plateformes pour organiser des manifestations et attirer l’attention internationale.
Le rapport Reuters Institute digital 2024, révèle que «le taux de confiance dans les informations sur les réseaux sociaux est relativement haut en Afrique (plus de 50%) comparé à l’Europe. Au Maroc, ce taux de confiance est relativement bas (31%)». Mais l’intégration opaque de l’IA, combinée aux antécédents de modération controversée sous Musk, risque d’éroder cette confiance, essentielle dans des régions où les réseaux sociaux compensent souvent les lacunes des médias traditionnels.
Cette photographie d'illustration prise à Bruxelles le 18 novembre 2024 montre les logos du réseau social américain X (ancien Twitter) (à gauche) et Bluesky affichés sur un téléphone portable.. AFP
Une plateforme recentrée sur l’IA: avantages et écueils
Elon Musk ambitionne de transformer X en une «application universelle» intégrant étroitement réseaux sociaux et IA, une vision aux implications contrastées pour les utilisateurs africains. D’un côté, cette fusion pourrait offrir des fonctionnalités perçues comme avantageuses, une personnalisation accrue des contenus, grâce à des algorithmes entraînés sur des données reflétant les spécificités culturelles ou linguistiques locales, ou des services intégrés comme Grok, capable de proposer des traductions en langues africaines ou une assistance technique adaptée aux besoins régionaux.
Lire aussi : Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire: les menaces commerciales à suivre de près en 2025, selon Allianz
Toutefois, ces innovations technologiques risquent d’accentuer la fracture numérique. Seuls 35% des Africains utilisent les réseaux sociaux, et les zones rurales où la pénétration plafonne à 25-30 % en Afrique centrale, pourraient être exclues de ces avancées, renforçant les inégalités d’accès au numérique.
Par ailleurs, l’IA de xAI pourrait reproduire, voire amplifier, des biais préexistants. Les contenus en swahili, haoussa ou autres langues locales, sous-représentés dans les jeux de données, risquent d’être marginalisés par des algorithmes optimisés pour l’anglais ou le français.
Enfin, la priorisation des abonnés Premium+- moins de 1 % des utilisateurs- crée une hiérarchie d’accès aux services premium, excluant une majorité d’Africains déjà confrontés à des contraintes économiques. Cette logique de monétisation sélective, couplée à une automatisation croissante, pourrait transformer X en une plateforme à deux vitesses, où l’innovation profite d’abord à une élite connectée, au détriment d’une inclusion numérique pourtant vitale pour le développement du continent.
Coût financier et publicité ciblée
X, valorisé à 33 milliards de dollars (contre 44 milliards en 2022), cherche à relancer sa croissance via l’IA. Mais pour les start-ups africaines, cette fusion complique la concurrence. Les géants comme Meta (WhatsApp, 250 millions d’utilisateurs en Afrique) ou TikTok (30 millions) dominent déjà et éclipsent les plateformes locales comme Nairaland (Nigeria) ou Mxit (Afrique du Sud), qui peinent à rivaliser faute de moyens technologiques et financiers. L’intégration de l’IA pourrait certes optimiser la publicité ciblée sur X, attirant les annonceurs locaux grâce à une hyperpersonnalisation des campagnes.
Lire aussi : Microsoft va investir 298 millions de dollars dans l’IA en Afrique du Sud
Mais cette hyperpersonnalisation accentue la dépendance aux infrastructures étrangères. A cela s’ajoute le fait qu’aucun pays africain ne figure parmi les hubs de calcul de xAI, basés aux États-Unis et en Europe. Ce qui exclue toute souveraineté numérique africaine. Les données des utilisateurs, transformées en carburant algorithmique, alimentent des serveurs extraterritoriaux, privant le continent de la valeur générée par ses propres ressources numériques. Un paradoxe qui soulève une question cruciale : l’Afrique deviendra-t-elle un simple réservoir de données pour des IA conçues ailleurs, ou parviendra-t-elle à structurer une économie numérique autonome?
Trois scénarios pour 40 millions d’utilisateurs
Ainsi, trois scénarios se dessinent pour les 40 millions d’utilisateurs africains de X. Le premier implique une exploitation des données sans garde-fous: les contenus, y compris ceux supprimés, alimenteront Grok dans une opacité totale, tandis que des gouvernements pourraient instrumentaliser ces données à des fins de surveillance politique, comme lors des mouvements sociaux.
Le deuxième scénario anticipe une marginalisation accrue des créateurs locaux : déjà moins rémunérés que sur TikTok ou Instagram, ceux-ci verraient leur visibilité réduite par des algorithmes favorisant les contenus en anglais ou alignés sur les intérêts des marchés occidentaux.
Lire aussi : Après un satellite mis en orbite, une caravane de l’espace: le Sénégal, les yeux pleins d’étoiles, en pole position
Enfin, un troisième scénario esquisse une mobilisation juridique et activiste : inspirés par l’enquête canadienne contre X, des pays comme le Maroc (21,2 millions d’utilisateurs) ou le Kenya (5 millions) pourraient durcir leurs lois sur la protection des données, tandis que des organisations ou des campagnes qui se concentrent sur les questions de colonialisme des données et de souveraineté numérique pourraient exiger des compensations pour l’exploitation des données africaines.
C’est le lieu de rappeler qu’en mai 2024, le ministère de la Justice du Maroc a annoncé la préparation d’un projet de loi ambitieux visant à encadrer spécifiquement l’IA. Ce projet inclut 17 articles couvrant des aspects tels que la gouvernance avec la création d’un comité national dédié à la supervision des systèmes d’IA, la conformité en matière de cybersécurité et de respect de la vie privée, ou encore l’intégration des données personnelles dans un cadre légal adapté aux défis technologiques actuels.
Autant de scénarios qui reflètent les tensions entre innovation technologique et protection des droits, dans un contexte où l’Afrique tente de négocier sa place dans l’écosystème global de l’IA.
Lire aussi : Voici les tarifs douaniers annoncés par Trump et leurs impacts sur les économies africaines
Ainsi, le rachat de X par xAI incarne les paradoxes de la tech africaine: promesse d’innovation contre risques d’exploitation. Pour les 40 millions d’utilisateurs africains, l’enjeu réside dans la capacité des régulateurs, entreprises et société civile à négocier un équilibre entre progrès technologique et protection des droits fondamentaux. Comme le souligne Stéphane Madrange: «À l’ère de l’IA, plus personne ne demande la permission». L’Afrique, terre de croissance numérique, doit désormais écrire ses propres règles.
xAI et l’Afrique : entre promesses technologiques et colonialisme des données
| Pays | Statistiques/Contexte | Enjeux/Problématiques clés | Initiatives/Scénarios |
|---|---|---|---|
| Nigeria | - 10 millions d’utilisateurs actifs sur X. - Mouvements sociaux (#EndSARS) organisés via la plateforme. - Taux de confiance élevé dans les réseaux (>50%). | - Risque d’exploitation des données pour l’entraînement de Grok. - Possible instrumentalisation politique des données. | - Potentielle mobilisation juridique inspirée par l’enquête canadienne contre X. |
| Afrique du Sud | - 8 millions d’utilisateurs actifs. - Mouvement #FeesMustFall soutenu par X. - Taux de confiance élevé dans les réseaux. | - Marginalisation des contenus en langues locales par les algorithmes. - Fracture numérique (zones rurales à faible taux de pénétration). | - Développement potentiel de lois sur l’IA, inspiré du modèle marocain. |
| Maroc | - 21,2 millions d’utilisateurs. - Taux de confiance relativement bas dans les réseaux (31%). - Projet de loi sur l’IA annoncé en 2024 (17 articles). | - Régulation floue malgré un cadre légal en construction. - Risque de surveillance accrue via l’IA. | - Leadership régional possible grâce au projet de loi sur l’IA. - Renforcement de la gouvernance des données. |
| Kenya | - 5 millions d’utilisateurs actifs. - Utilisation de X pour l’activisme et l’information. | - Dépendance aux infrastructures étrangères. - Sous-représentation des données locales dans les modèles d’IA. | - Possibles campagnes sur les questions de colonialisme des données pour exiger des compensations. |
Source : Rapport Reuters Institute digital 2024; données de X.