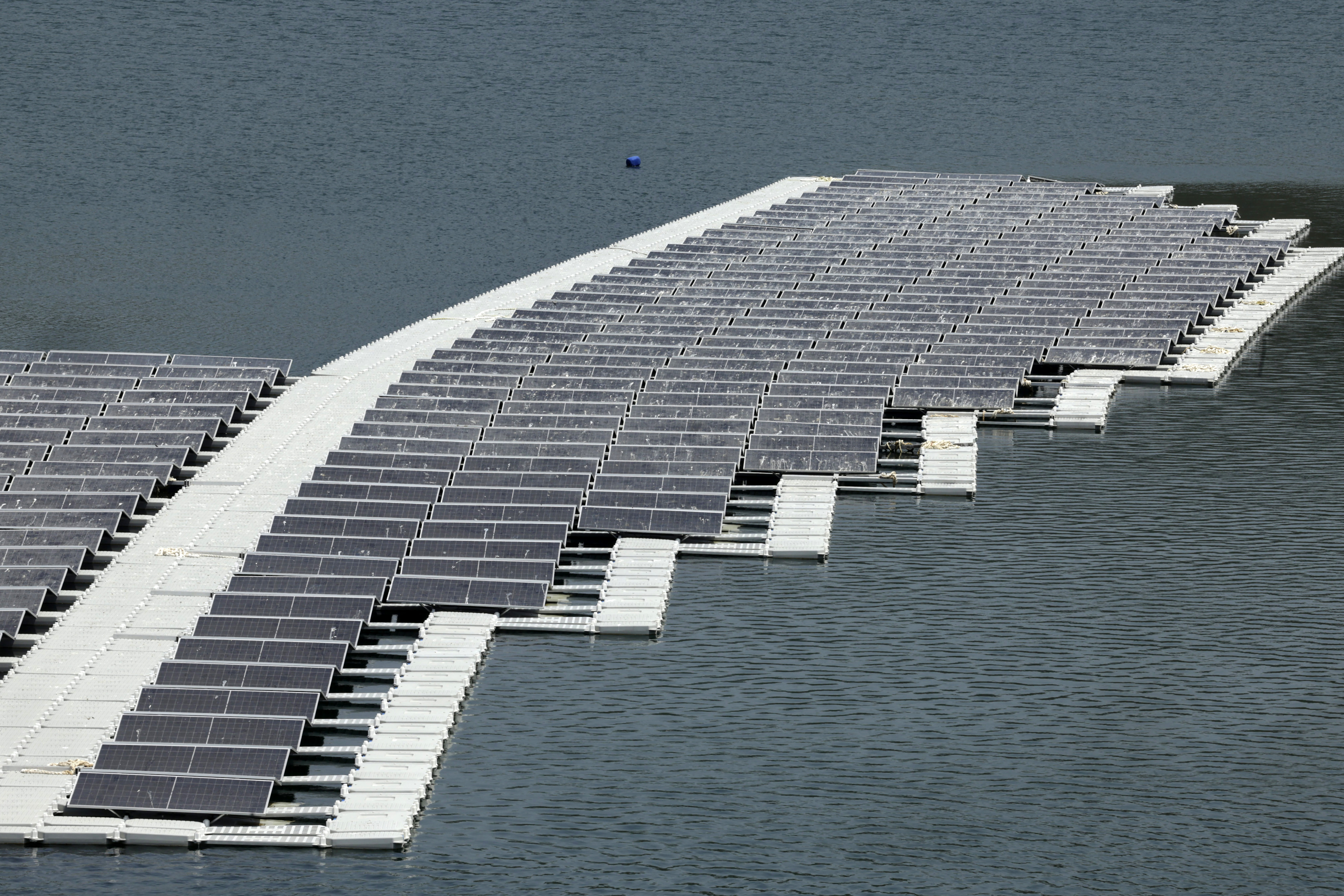L’Afrique est l’épicentre de la crise mondiale de l’eau. C’est dans ce contexte que la Banque mondiale insiste sur l’urgence d’une révolution tarifaire et économique en matière de gestion du stress hydrique en Afrique, mettant l’accent sur le coût de l’inaction et l’impératif d’actions concertées.
Dans le récent rapport dénommé «Global Water Monitoring Report: Continental Drying», la Banque mondiale sonne l’alarme. L’Afrique subit de plein fouet l’assèchement continental, une réduction à long terme de ses réserves d’eau douce aux conséquences économiques et sociales dévastatrices. Zoom sur les enjeux pour les acteurs économiques du continent.
Lire aussi : Chute des cours de matières premières en 2026: l’impact sur ces 10 pays africains selon la Banque mondiale
La convergence des données est frappante. Alors que le rapport de la Banque mondiale dresse une liste de pays africains où la consommation de l’eau dépasse l’offre renouvelable– Maroc, Algérie, Tunisie et Niger– le classement du World Resources Institute (WRI) vient en révéler la gravité hiérarchisée. Non seulement le WRI confirme le diagnostic pour ces pays, mais il montre que la Tunisie, la Lybie, l’Egypte, la Namibie, le Botswana, l’Afrique du Sud et Eswatini subissent un stress hydrique extrêmement élevé, tandis que le Maroc, l’Algérie, le Niger et l’Erythrée sont confrontés à un stress élevé. A ceux-là s’ajoutent la Mauritanie, le Sénégal et le Zimbabwe, qui subissent un stress hydrique moyennement élevé. Des nations qui font partie des «méga-régions d’assèchement» continentales émergentes.
Comme le souligne Axel van Trotsenberg, directeur général principal du développement et des politiques à la Banque mondiale, «l’eau est la vie. Pourtant, à travers les continents, cette ressource vitale disparaît à un rythme alarmant. Ce n’est plus un risque futur; c’est une crise silencieuse qui affecte les économies, les écosystèmes et les vies».
L’agriculture, consommatrice de 98% de l’empreinte eau globale, est au cœur du problème. Le rapport pointe les pays africains où une large part de la consommation agricole d’eau est inefficace, c’est-à-dire utilisant plus d’eau par tonne produite que la moitié des producteurs mondiaux dans des conditions climatiques et technologiques similaires: Algérie et Tunisie.
Lire aussi : Environnement: en 2025, l’Afrique devrait consacrer 30% de ses revenus au service de la dette climatique
Dans ces pays, une part significative de la production agricole dans les régions déjà en assèchement repose sur des pratiques gourmandes en eau et peu performantes. Le rapport note que «plus des deux tiers de l’irrigation inefficace dans les régions d’assèchement sont liés à des cultures gourmandes en eau, telles que le riz, le blé, le coton, le maïs ou la canne à sucre». Une inefficacité qui aggrave la pénurie.
Face à ce constat, le rapport insiste sur la réforme de la tarification comme levier clé. Il identifie explicitement les pays africains qui gagneraient à réformer la tarification de l’eau. La Banque mondiale entend par là les pays où plus de 20% des terres cultivées sont irriguées et où persiste un sous-prix de l’eau agricole favorisant le pompage excessif, contribuant à la perte des réserves. Si le rapport ne liste pas exhaustivement ces pays africains, le diagnostic sur l’Algérie et la Tunisie (stress combiné à l’inefficacité) implique fortement que ces réformes y seraient bénéfiques.
Heureusement, d’autres modèles existent. Le rapport cite des pays africains exemplaires en matière de réforme tarifaire de l’eau. C’est le cas pour le Ghana où le modèle de tarification rurale est salué. Les gestionnaires locaux fixent les tarifs «sur la base de l’accessibilité financière et de la durabilité financière». Les groupes à revenus plus élevés paient des tarifs plus élevés, finançant la récupération des coûts et l’investissement dans les infrastructures. Les populations à faible revenu bénéficient de tarifs subventionnés. Ce système a permis «une expansion rapide sans précédent de l’accès tout en stabilisant les finances des services publics».
Des femmes et enfants avec des bidons à la recherche d'eau à Nouakchott.. A. Seck/Le360 Afrique
Deuxième pays exemplaire cité: le Maroc. Le Royaume est montré en exemple pour ses «tarifs basés sur la performance» dans les grands périmètres irrigués, liant les redevances aux volumes consommés et à la performance des infrastructures. Cette réforme, associée à l’adoption de l’irrigation goutte-à-goutte, «a conduit à une réduction de 30% de l’utilisation de l’eau agricole».
Comme le montre l’analyse économique du rapport, la sous-évaluation et la sous-tarification de l’eau encouragent une utilisation excessive et l’inefficacité, exacerbant l’assèchement continental. Des tarifs reflétant la rareté et la valeur de l’eau sont essentiels pour inciter à l’adoption de technologies économes (goutte-à-goutte) et à une allocation efficace.
Le rapport de la Banque mondiale révèle un déficit de financement criant de 6,7 billions de dollars d’ici 2030 pour une gestion durable de l’eau, représentant une opportunité stratégique majeure pour les investisseurs privés et les institutions financières. Ainsi, trois domaines clés émergent comme prioritaires d’investissement. Premièrement, les technologies d’efficacité hydrique, incluant le déploiement à grande échelle de systèmes d’irrigation de précision (goutte-à-goutte, pivots centraux), de capteurs intelligents pour l’agriculture, et de plateformes exploitant les données satellitaires GRACE à haute résolution permettant un suivi fin des réserves d’eau souterraine.
Lire aussi : Dette des pays africains: 70% de la hausse dus à la dépréciation des monnaies locales
Deuxièmement, les infrastructures non conventionnelles telles que les usines de réutilisation des eaux usées traitées et le dessalement alimenté par énergies renouvelables, sous réserve d’une viabilité économique et d’une gestion rigoureuse de la saumure pour limiter les impacts écologiques.
Troisièmement, la réduction des pertes d’eau non comptabilisées (NRW) via la modernisation des réseaux, comme démontré à Faisalabad (Pakistan) où les fuites ont été réduites de 30%. Pour mobiliser ces capitaux, les partenariats public-privé (PPP) s’imposent comme le modèle central, exigeant une clarification des règles, des cadres juridiques solides (référencés dans la feuille de route proposée par la Banque Mondiale), et des mécanismes de tarification assurant un retour sur investissement. Le rapport souligne que des instruments innovants – obligations vertes/bleues, finance mixte, et garanties de risque – sont indispensables pour transformer ce déficit en portefeuille d’opportunités bancables.
Risque opérationnel, responsabilités et opportunités
Disons que la pénurie d’eau constitue un risque opérationnel systémique pour les entreprises industrielles et les chaînes de valeur non agricoles, compromettant la stabilité des approvisionnements, perturbant les processus industriels dépendants de l’eau (refroidissement, transformation) et déstabilisant les contextes socio-économiques locaux.
Une vulnérabilité qui exige une réponse stratégique intégrée. Alors que l’empreinte hydrique (« water footprint ») devient un critère commercial déterminant sous l’impulsion de normes de durabilité dans des accords comme le partenariat Inde-Japon ou la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), les entreprises doivent impérativement cartographier leur dépendance directe et celle de leurs fournisseurs agricoles (coton, intrants alimentaires), investir dans l’optimisation interne via le recyclage en boucle et des audits complets, et migrer vers des chaînes d’approvisionnement «water-positive».
Lire aussi : Entre l’Ethiopie et l’Erythrée, le spectre d’un nouveau conflit
Le rapport souligne l’émergence inéluctable de mesures non tarifaires côté demande (« demand-side NTMs »), incluant l’étiquetage obligatoire de l’intensité hydrique des importations et des certifications pour produits sobres en eau, transformant la gestion de la ressource en impératif de compétitivité. Ainsi, intégrer la valorisation de l’eau dans les stratégies RSE et les politiques d’achats n’est désormais plus optionnel mais conditionne la résilience opérationnelle et l’accès aux marchés exigeants.
Quid du partage de risques, de la coopération transfrontalière ?
Pour la Banque Mondiale, l’intervention des partenaires internationaux et institutions financières doit se concentrer sur trois leviers prioritaires identifiés dans la feuille de route politique du rapport. En premier lieu, le financement doit cibler le renforcement des institutions de bassin pour une gouvernance intégrée, l’appui technique aux réformes tarifaires incluant des mécanismes de protection sociale, le déploiement de systèmes de suivi haute résolution (compteurs intelligents, données GRACE downscalées à 25 km), et les projets hybrides associant efficacité agricole, restauration du stockage naturel (zones humides, recharge d’aquifères) et infrastructures résilientes.
Leur rôle de dé-risquage est indispensable: en structurant des instruments financiers innovants comme les obligations indexées sur des résultats hydriques tangibles, en fournissant des garanties partielles et en mutualisant les risques, ils catalysent la mobilisation des capitaux privés à l’échelle requise pour combler le déficit de 6,7 billions de dollars.
Lire aussi : Sénégal: le Lac Rose redevient enfin rose, le tourisme reprend des couleurs
Enfin, le soutien diplomatique et technique des partenaires internationaux et institutions financières à la coopération transfrontalière est crucial pour établir des cadres institutionnels et des accords de gestion dans les bassins partagés – à l’image du fleuve Sénégal ou des aquifères transfrontaliers – là où le rapport constate un déficit majeur, plus de la moitié des cours d’eau internationaux et quasi tous les aquifères transfrontaliers manquant encore de mécanismes de coordination, menaçant la sécurité hydrique régionale.
Ainsi, le rapport de la Banque Mondiale démontre que le statu quo est économiquement intenable. Après ce qui précède, la feuille de route est claire et nécessite une action concertée de tous les acteurs. Les réformes tarifaires, comme celles exemplaires du Ghana (modèle rural inclusif) et du Maroc (tarification liée à la performance et volumes), ne sont pas une option mais une nécessité économique pour signaler la valeur de l’eau et financer sa gestion durable.
L’investissement massif dans l’efficacité, porté par des PPP innovants et une finance verte/bleue mobilisée, est le seul moyen de combler le déficit de financement abyssal. La diversification économique hors des secteurs fortement dépendants de l’eau est une stratégie de résilience vitale pour les économies nationales et les moyens de subsistance locaux, soulageant la pression sur la ressource.
Lire aussi : Ports: comment ont évolué les 5 plus grands terminaux à conteneurs africains depuis 2020
L’avertissement de Van Trotsenberg résonne particulièrement pour l’Afrique. «Avec les bonnes connaissances, les partenariats et la volonté politique, nous pouvons inverser la tendance», fait-il valoir. L’heure n’est plus au diagnostic, mais à la mise en œuvre urgente et concertée de solutions dont les piliers économiques– tarification juste, investissement ciblé, diversification– sont désormais incontournables pour assurer un avenir hydrique et économique viable au continent. D’autant plus que le coût de l’inaction se mesure déjà en emplois perdus.
Stress hydrique en Afrique: réformer la tarification et investir pour éviter l’effondrement
| Aspect | Points clés |
|---|---|
| Constats alarmants | - Pays africains qui subissent un stress hydrique extrême (Tunisie, Libye, Égypte, Namibie, Botswana, Afrique du Sud, Eswatini). - Pays qui subissent un stress hydrique élevé (Maroc, Algérie, Niger, Érythrée). - Pays qui subissent un stress hydrique moyennement élevé (Mauritanie, Sénégal, Zimbabwe). - Assèchement continental : réduction des réserves d’eau douce (+ risques économiques et sociaux). - Agriculture responsable de 98% de l’empreinte eau, avec inefficacité en Algérie/Tunisie. |
| Causes majeures | - Cultures gourmandes en eau (riz, blé, coton) dans des zones arides. - Sous-tarification de l’eau agricole → pompage excessif. - Déficit de gouvernance (50% des cours d’eau transfrontaliers sans accord). |
| Solutions clés | - Réforme tarifaire : Exemples réussis au Ghana (tarifs progressifs) et Maroc (-30% d’eau via tarification liée aux volumes). - Investissements prioritaires : Irrigation de précision, dessalement écologique, réduction des fuites (ex: Pakistan -30%). - Financements innovants : PPP, obligations vertes/bleues, finance mixte (déficit de 6,7 billions $ d’ici 2030). |
| Risques & opportunités | - Risques : Pertes d’emplois, instabilité socio-économique, barrières commerciales (normes « water footprint »). - Opportunités : Marchés des technologies hydro-efficaces, diversification économique, certifications « eau positive ». |
| Feuille de route | 1. Renforcer les institutions de bassins transfrontaliers. 2. Déployer des systèmes de monitoring haute résolution (données satellitaires). 3. Appui diplomatique aux accords de coopération (exemple: fleuve Sénégal). |
Source: Banque Mondiale.