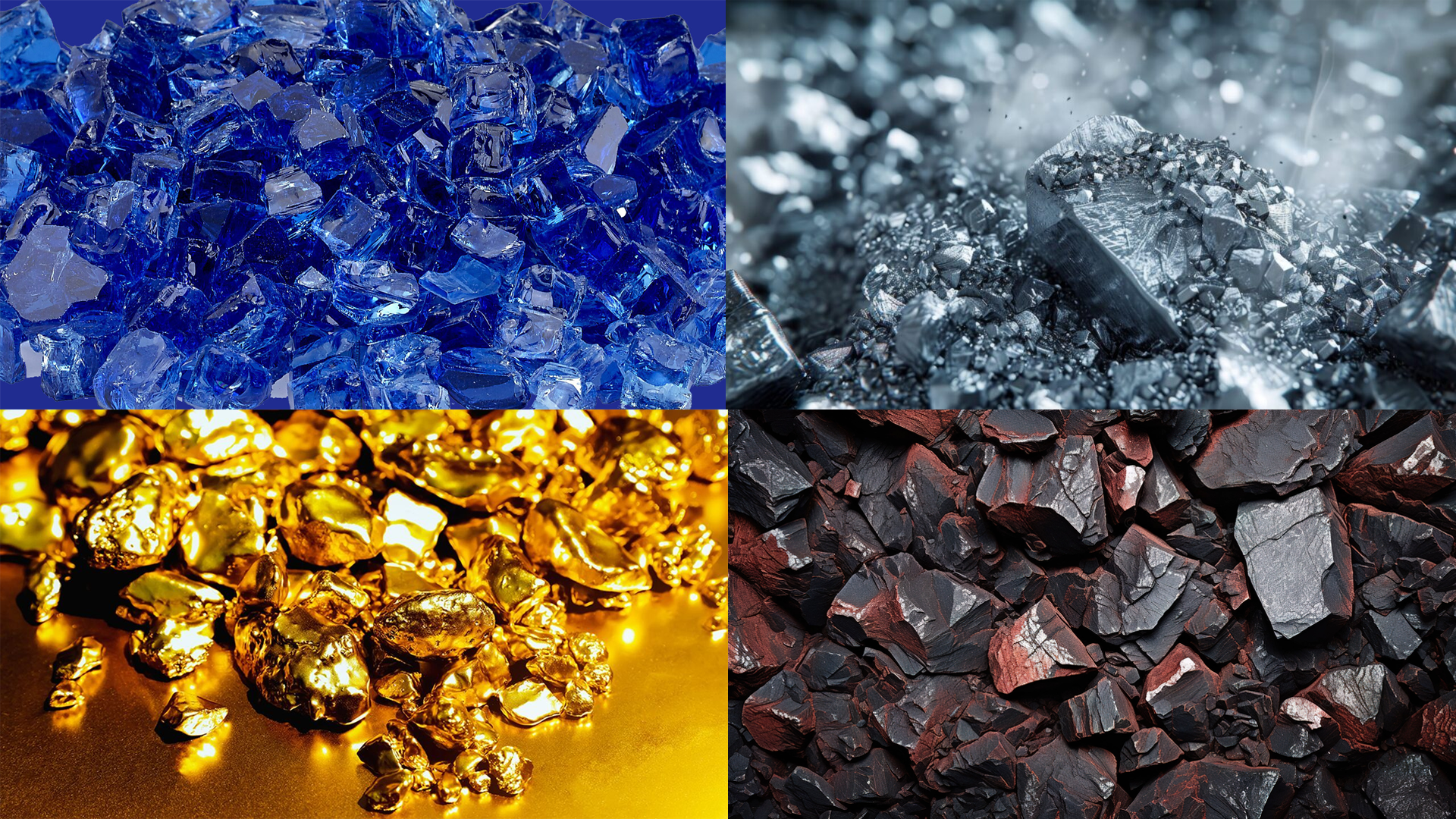Le récent rapport 2025 de l’OCDE sur les restrictions à l’exportation des matières premières industrielles révèle une accélération sans précédent de ces mesures, avec une croissance quintuplée depuis 2009. En Afrique et dans le reste du monde, plusieurs pays émergent comme acteurs clés de cette tendance, motivés par des impératifs économiques, stratégiques et industriels.
C’est le cas pour sept pays- Chine, Viet Nam, Burundi, Fédération de Russie, République démocratique du Congo, Zimbabwe et Laos–. Comme le souligne l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) «près de 94% des nouvelles restrictions en 2023 proviennent de sept pays, dont trois africains. Ces mesures reflètent une volonté croissante de contrôler les ressources stratégiques et de transformer les modèles économiques».
Analysons les dynamiques africaines, en décortiquant les pays concernés, les outils privilégiés, les matières ciblées et les justifications avancées, tout en interrogeant leurs implications dans un contexte de tensions géopolitiques et de dépendances mondiales.
Entre souveraineté et stratégie industrielle
En 2023, trois pays africains- Burundi, RDC et Zimbabwe- se sont imposés comme des acteurs majeurs dans la vague globale de restrictions à l’exportation, représentant collectivement 34% des mesures nettes introduites (Burundi: 21%, RDC: 7%, Zimbabwe: 6%).
En y voyant de plus près, l’on constate que le Burundi a opté pour des réformes fiscales ciblant les exportations, instaurant ou révisant des taxes sur les matières premières, dans un objectif affiché de renflouer les caisses de l’État.
Lire aussi : En crise aiguë, résilientes et les entre-deux: l’appréciation de la Banque mondiale des monnaies africaines
À l’inverse, la RDC et le Zimbabwe ont déployé des interdictions totales d’exportation, notamment sur les minerais bruts, afin de contraindre les entreprises minières à transformer localement ces ressources. Des stratégies qui illustrent une tension entre logiques budgétaires courtermistes et ambitions industrielles à long terme.
D’autres pays africains (Gabon, Ghana, Guinée, Afrique du Sud), bien que couverts par l’Inventaire de l’OCDE, restent marginaux dans ce mouvement, appliquant des restrictions sporadiques et moins radicales. Une dynamique qui s’inscrit dans un contexte où les États africains cherchent à rompre avec leur rôle traditionnel de fournisseurs de matières premières brutes, tout en faisant face à des impératifs de souveraineté économique exacerbés par les crises géopolitiques récentes.
Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce du Maroc. Le Royaume a adopté depuis quelques années une stratégie plus interventionniste ciblant notamment les exportations de lingots de cuivre, d’aluminium, et les exportations de cuivre jaune (alliage cuivre-zinc).. le360
Maroc: contrôle régulatoire graduel
Si le Maroc n’apparaît pas parmi les pays africains les plus actifs en matière de restrictions à l’exportation entre 2009 et 2023, période prise en compte par l’étude de l’OCDE, il a adopté depuis quelques années une stratégie plus interventionniste. En mars 2025, un arrêté ministériel a instauré une obligation de licence d’exportation pour les lingots de cuivre et d’aluminium, des métaux non ferreux, applicable sur 24 mois, afin de limiter les exportations «sauvages» et de réserver ces ressources aux industries locales, notamment électriques et automobiles.
Une mesure qui s’inscrit dans une logique de souveraineté industrielle, renforcée par la prolongation jusqu’en février 2026 des contrôles sur les exportations de cuivre jaune (alliage cuivre-zinc), en vigueur depuis 2021 et reconduits en 2023 et 2024.
Lire aussi : Discipline budgétaire en Afrique: les pays qui inquiètent le FMI et les autres
Contrairement aux interdictions radicales de la RDC ou du Zimbabwe, le Maroc privilégie un contrôle régulatoire graduel, combinant traçabilité accrue et incitations à la transformation locale. L’OCDE, sans mentionner explicitement le Royaume dans son rapport 2025, observe que ces mesures «s’alignent sur une tendance régionale à encadrer les flux de matières premières critiques, tout en évitant les mesures les plus disruptives».
Toutefois, ce modèle hybride– moins brutal que les interdictions mais plus complexe à gérer– soulève des défis: l’administration marocaine doit concilier attractivité des investisseurs miniers et priorités industrielles nationales, dans un contexte où le Maroc est le troisième producteur de cuivre en Afrique, avec une production de 92.612 tonnes de concentré de cuivre en 2023, principalement assurée par le groupe Managem. Une équation délicate, mais révélatrice des nouveaux équilibres que cherchent les économies africaines face à la convoitise mondiale pour leurs ressources.
Les restrictions dominantes
Les pays africains privilégient deux types de restrictions aux effets économiques distincts: les taxes à l’exportation et les interdictions pures. Le Burundi illustre la première approche, alignant ses mesures sur une logique de génération de revenus publics via des prélèvements fiscaux qui renchérissent les coûts d’exportation. Bien que moins radicales que les interdictions, ces taxes augmentent le coût ou réduisent la rentabilité de l’exportation de matières premières brutes, favorisant indirectement leur transformation locale.
À l’opposé, la RDC et le Zimbabwe ont adopté des interdictions totales, bloquant l’exportation de minerais stratégiques comme le cobalt ou le platine, officiellement pour catalyser l’émergence de filières industrielles nationales.
Si les taxes dominent le paysage mondial (54% des nouvelles mesures en 2023), l’Afrique se distingue par un recours accru aux interdictions (23% des mesures globales), outil prohibitif aux implications géoéconomiques lourdes.
L’OCDE met en garde contre les risques systémiques de ces mesures: «elles peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement et déclencher des représailles commerciales». Une dualité qui reflète un équilibre complexe entre volonté d’affirmation souveraine- les interdictions servant de signal politique fort- et nécessité de respecter les règles du commerce international, où les taxes restent moins contestables que les quotas ou embargos. Toutefois, l’efficacité réelle de ces outils reste sujette à caution, notamment dans des économies souvent dépourvues d’infrastructures de transformation compétitives.
Matières contrôlées et captation de la valeur
Les restrictions africaines se concentrent sur des matières premières stratégiques, reflets des enjeux géoéconomiques de la transition énergétique et numérique. En tête figure le cobalt, dont 67% du commerce mondial est soumis à des restrictions, principalement en RDC, pays qui produit 70% de l’offre globale. En interdisant l’exportation de minerais bruts, la RDC ambitionne de capter la valeur ajoutée liée à la fabrication de batteries électriques, secteur dominé par la Chine et l’Europe.
Le cuivre et le manganèse, essentiels aux infrastructures vertes, subissent également des taxes ou quotas, comme au Zimbabwe et au Gabon, dans une logique de diversification économique. Le Zimbabwe, troisième producteur mondial de platine, restreint quant à lui les exportations de métaux du groupe platine (MGP) pour développer une filière locale de raffinage, répondant à la demande croissante de l’industrie automobile et de l’hydrogène.
Parallèlement, les déchets et rebuts métalliques font l’objet de contrôles accrus, motivés par des impératifs environnementaux et une volonté d’intégrer l’économie circulaire aux stratégies minières. Toutefois, l’OCDE nuance cet enthousiasme: «Ces politiques risquent de freiner le recyclage à l’étranger, pourtant parfois plus efficace», rappelant que les restrictions sur les déchets peuvent entraver les économies d’échelle nécessaires à une circularité réellement durable.
Entre discours et réalités économiques
Les gouvernements africains défendent leurs restrictions à l’exportation par trois arguments clés. Premièrement, la promotion de la transformation locale, illustrée par la RDC et le Zimbabwe, qui bloquent l’exportation de minerais bruts pour forcer les investisseurs à construire des usines de traitement sur leur territoire.
Lire aussi : Or artisanal: et si la Côte d’Ivoire s’inspirait du régulateur unique ghanéen
Deuxièmement, la génération de recettes fiscales, comme au Burundi, où les taxes à l’exportation compensent les budgets publics fragiles, malgré des doutes sur leur pérennité face à la volatilité des prix.
Troisièmement, la sécurité stratégique, avec des pays cherchant à réduire leur dépendance aux marchés globaux, notamment pour les minerais critiques (cobalt, lithium) dont la demande explose. Ces justifications, bien que rationnelles en apparence, se heurtent à des réalités économiques abruptes.
La RDC, par exemple, manque cruellement d’infrastructures énergétiques et logistiques pour transformer son cobalt à grande échelle, risquant de paralyser un secteur minier représentant 30% de ses exportations. Pire, ces mesures alimentent les tensions avec des partenaires comme la Chine ou l’Union européenne, dépendants de ces ressources pour leurs industries high-tech et vertes.
L’OCDE souligne que si «l’efficacité de ces restrictions à atteindre les objectifs de développement durable est contestée», leur persistance pourrait accentuer les déséquilibres commerciaux et technologiques, au détriment des économies africaines elles-mêmes.
Les restrictions à l’exportation africaines, bien que motivées par des impératifs légitimes, génèrent des risques systémiques pour l’économie mondiale et les États eux-mêmes. L’OCDE identifie trois menaces majeures. Premièrement, la fragmentation des chaînes d’approvisionnement, déjà mise en lumière plus haut par les interdictions congolaises sur le cobalt, minéral clé des batteries électriques.
Lire aussi : CNUCED: voici les 5 pays africains les plus résilients aux chocs exogènes
Une réduction drastique des exportations pourrait retarder la transition énergétique globale, alors que la demande de véhicules électriques croît de 35% au premier trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Deuxièmement, les effets domino: les mesures unilatérales africaines incitent des pays importateurs comme les États-Unis ou l’Inde à adopter des barrières similaires, alimentant une spirale protectionniste susceptible d’éroder les règles multilatérales de l’OMC.
Troisièmement, l’inefficacité structurelle des politiques, illustrée par le cas zimbabwéen, où l’absence d’usines de raffinage de platine rend les interdictions contre-productives, réduisant les revenus d’exportation sans créer d’emplois locaux.
Des risques qui appellent à un rééquilibrage délicat: les pays africains doivent conjuguer souveraineté économique et intégration responsable aux chaînes de valeur mondiales, sous peine d’isolement commercial ou de dépendance accrue aux prêteurs internationaux. L’enjeu dépasse la gestion des matières premières, il engage l’avenir d’un modèle de développement africain à la croisée des chemins.
Matières premières africaines : entre contrôle national et dépendance mondiale, l’équilibre précaire dénoncé par l’OCDE
| Points clés | Détails |
|---|---|
| Pays africains clés | Burundi (21% des mesures), RDC (7%), Zimbabwe (6%). Autres : Gabon, Ghana, Guinée, Afrique du Sud (mesures marginales). Maroc : contrôle régulatoire graduel. |
| Types de restrictions | Taxes à l’exportation (Burundi) vs interdictions totales (RDC, Zimbabwe). Dominance mondiale des taxes (54%), mais l’Afrique privilégie les interdictions (23%). |
| Matières ciblées | Cobalt (67% du commerce mondial restreint), cuivre, manganèse, platine, déchets métalliques. Enjeux liés à la transition énergétique et numérique. |
| Motivations | 1. Transformation locale (ex: RDC/Zimbabwe). 2. Revenus fiscaux (Burundi). 3. Sécurité stratégique (contrôle des minerais critiques). |
| Risques identifiés | Fragmentation des chaînes d’approvisionnement, représailles commerciales, inefficacité structurelle (manque d’infrastructures), isolement économique. |
| Position de l’OCDE | Met en garde contre les risques systémiques, souligne l’inefficacité des mesures pour le développement durable, et prône un équilibre entre souveraineté et intégration mondiale. |
Source : OCDE.