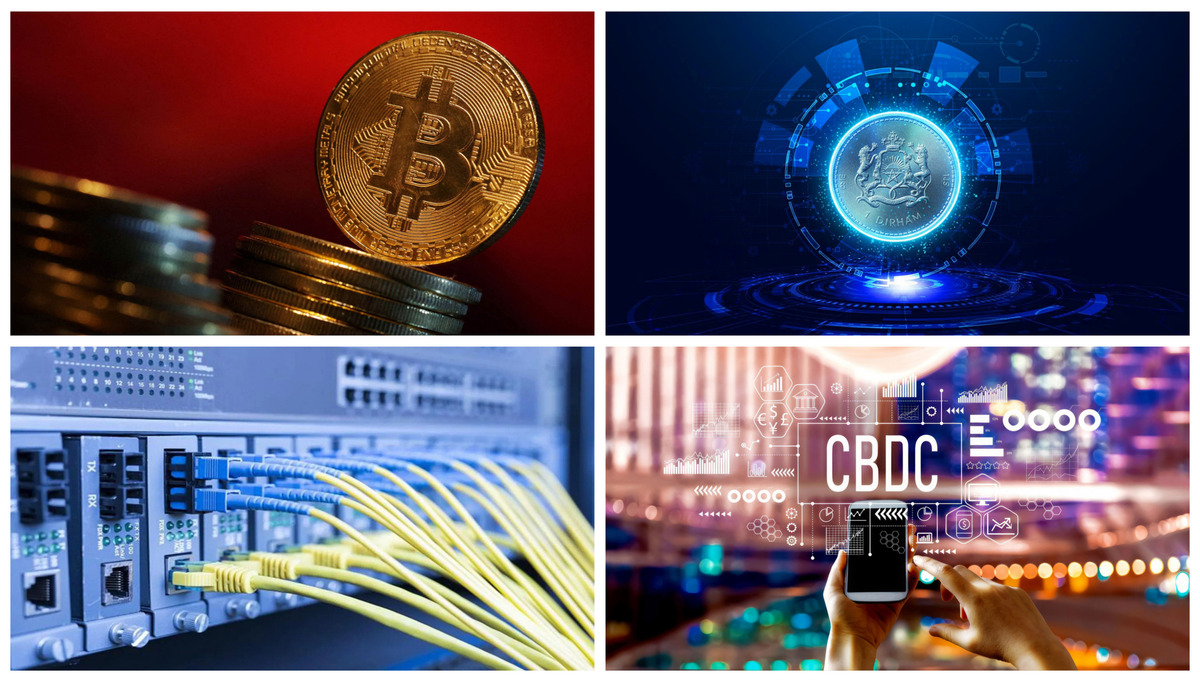Un récent article publié par la Banque mondiale (BM) révèle une évolution stratégique dans son approche des projets, qu’ils soient liés à la santé, l’éducation, le climat, ou encore le numérique. Disons que les nouvelles données du tableau de bord de la BM lui permettent désormais d’évoluer vers une approche intégrée, où tout projet est évalué à l’aune de sa contribution à l’emploi.
Lire aussi : Gabon. Assainissement des finances publiques: le coup de pied dans la fourmilière
Concrètement, cela induit des changements pour un certain nombre d’acteurs, notamment en Afrique. A commencer par les gouvernements. La BM les incite désormais à mener des réformes structurelles (fiscales, éducatives, de gouvernance) pour créer un environnement propice à l’emploi.
Pour les citoyens et entrepreneurs, cela est désormais synonyme d’opportunités concrètes qui émergent dans les secteurs verts, le numérique, les infrastructures et l’entreprenariat féminin, soutenues par des financements et des appuis techniques.
Pour les acteurs économiques, cela implique désormais qu’ils doivent développer leur propre «réflexe du résultat» et penser leur activité en termes de création d’emplois durables et de moyens de subsistance, car c’est le critère central autour duquel s’alignent désormais les financements et les politiques de développement.
Ainsi, la publication des résultats du «Tableau de Bord» de la BM pour l’exercice 2025 offre une photographie précieuse des impacts concrets des interventions de développement, particulièrement en Afrique.
Lire aussi : Sénégal. Diaspora bonds: l’État tend la main, les expatriés hésitent à mettre la leur à la poche
Au-delà des chiffres globaux, les études de cas de la Zambie, du Maroc, de Madagascar, de Côte d’Ivoire et de Guinée-Bissau révèlent des dynamiques complexes et des enseignements cruciaux pour l’ensemble des acteurs économiques du continent. Des résultats tangibles aux défis persistants, zoom sur les implications pour les acteurs économiques africains et ce qui change concrètement.
Un jeune utilisant son smartphone, pour accéder à des services de finance mobile ou de e-commerce, fruit du boom de la pénétration numérique en Guinée-Bissau.. le360 Afrique/seck
Les filets de sécurité en Zambie
Le modèle zambien documenté par la BM illustre l’efficacité transformative d’interventions intégrées ciblant les femmes rurales. Des «petites subventions» associées à des «formations professionnelles et du mentorat» ont généré des résultats tangibles: réduction de 30% de l’extrême pauvreté, augmentation de 80% des bénéfices des micro-entreprises et progression de l’épargne de plus de 230%.
Concrètement, cette approche dépasse l’assistance sociale traditionnelle en catalysant l’entrepreneuriat féminin, renforçant simultanément la résilience économique et l’autonomie des bénéficiaires. Pour les acteurs du développement rural et de la protection sociale, ces résultats valident une stratégie combinant transferts monétaires et renforcement des capacités productives comme levier de création de moyens de subsistance durables. En conséquence, les gouvernements et agences de développement doivent prioriser des programmes similaires intégrant capital, compétences et accompagnement.
Lire aussi : Economie numérique: comment régulation, inclusion et transformation redessinent ces économies africaines
Le secteur privé local y trouve l’émergence d’une clientèle et de fournisseurs plus solvables, tandis que les ONG doivent aligner leurs interventions sur cette logique d’autonomisation économique pour maximiser l’impact systémique.
Maroc: santé, emploi et gouvernance
Selon la BM, les réformes marocaines de la couverture santé universelle démontrent un double dividende stratégique: amélioration de l’accès aux soins pour les populations et création d’emplois dans le secteur des soins. Concrètement, la refonte de la gouvernance sanitaire agit comme un vecteur direct de formalisation de l’emploi, générant des postes pour les professionnels de santé et le personnel de soutien. Une dynamique qui stimule un secteur économique clé tout en renforçant le capital humain, élément fondamental pour la productivité future.
Pour les gouvernements africains, le cas marocain offre un modèle opérationnel liant réformes sectorielles et politiques d’emploi, transformant les systèmes de santé en investissements économiques. Le secteur privé (cliniques, équipementiers) bénéficie d’une demande accrue et d’un cadre réglementaire structuré, attirant les investisseurs vers un marché porteur. Enfin, les citoyens gagnent en accès aux soins et en opportunités professionnelles, illustrant comment une réforme de gouvernance peut concilier inclusion sociale et croissance économique.
Madagascar: finances publiques, dette et investissement
Le cas malgache démontre la corrélation stratégique entre rigueur macroéconomique et développement inclusif. Une «meilleure gestion de la dette», explicitement citée, a généré une «marge de manœuvre budgétaire» pour financer des investissements créateurs d’«emplois dans les infrastructures et des moyens de subsistance». Une dynamique qui transforme l’assainissement budgétaire en catalyseur d’investissements productifs, où chaque dollar d’économie sur le service de la dette se convertit en projets concrets de BTP et de services annexes, générateurs d’emplois formels et d’activités locales.
Lire aussi : Voici les 10 ports les plus performants d’Afrique en 2024
Pour les gouvernements, cette logique impose de requalifier la gestion de la dette en investissement préalable au développement. Les entreprises de construction et d’ingénierie deviennent les premiers bénéficiaires de ces programmes revitalisés, tandis que les institutions financières doivent concevoir des instruments de restructuration adaptés aux contextes fragiles.
En définitive, les populations accèdent simultanément à des infrastructures améliorées (routes, énergie) et à des opportunités d’emplois stables, matérialisant ainsi le passage d’une austérité subie à une croissance structurante.
Côte d’Ivoire: énergie et infrastructures connectées
Selon la BM, l’intervention de son groupe en Côte d’Ivoire révèle l’effet multiplicateur des infrastructures énergétiques sur l’écosystème économique. Le soutien de l’IFC et de la MIGA à «l’expansion du réseau électrique» produit un double dividende: création immédiate d’emplois dans «la construction et la maintenance», et effet structurant via l’accès fiable à l’électricité– socle indispensable aux activités productives industrielles, numériques et de services.
Pour la Côte d’Ivoire, cela comble un déficit historique entravant la compétitivité hors secteur agricole. Une transition qui impose aux gouvernements d’ériger l’énergie en priorité absolue des plans de développement. Les énergéticiens et sociétés de BTP y trouvent un marché dynamique, tandis que les industries et PME locales bénéficient d’une réduction drastique des coûts opérationnels liés aux délestages. Les ménages, quant à eux, voient émerger de nouvelles opportunités de télétravail, d’éducation numérique et de micro-entreprises, faisant de l’électrification un accélérateur transversal d’inclusion socioéconomique.
Guinée-Bissau: transformation numérique et inclusion
L’essor numérique Guinée-Bissau illustre l’impact transformateur des réformes réglementaires ciblées. Selon la BM, la triple action de l’IDA, de l’IFC et de la MIGA a propulsé «la pénétration du numérique de 12 à 36 % en quatre ans», ouvrant la voie aux «emplois numériques, à la finance mobile et aux marchés en ligne». Un bond qualitatif qui pose les bases d’une économie numérique inclusive, particulièrement cruciale pour les zones rurales où la connectivité devient un pont vers les marchés formels.
Pour les gouvernements, cet exemple impose une refonte des cadres réglementaires pour attirer les investissements dans les télécoms. Les opérateurs réseaux et entreprises tech accèdent à un marché en croissance exponentielle, tandis que les entrepreneurs et PME exploitent de nouveaux canaux de commercialisation (e-commerce) et de financement (mobile money). Les populations, enfin, gagnent un accès élargi aux services essentiels (télé-médecine, éducation en ligne) et à des revenus complémentaires via l’économie de plateforme, réduisant l’isolement géographique et économique.
Cinq tendances et défis majeurs pour l’Afrique
L’analyse consolidée des cinq cas africains révèle une réalité structurante : l’emploi émerge par de multiples leviers interconnectés– santé, éducation, finances publiques, numérique, énergie et égalité des sexes– confirmant qu’il existe de nombreuses voies vers l’emploi, et chacune mérite d’être mesurée, étudiée et renforcée. Une pluralité qui impose aux gouvernements et institutions de développement des stratégies multisectorielles intégrées, tandis que le secteur privé découvre des opportunités d’investissement au-delà des secteurs traditionnels, notamment dans l’économie verte et digitale.
Lire aussi : Urgence climatique et défis logistiques: pourquoi l’Égypte, le Maroc et le Cameroun misent sur le rail
Un paysage qui est redéfini par le nouveau paradigme de mesure d’impact de la Banque mondiale, qui dépasse le simple comptage des emplois créés pour cibler l’accès à des emplois mieux rémunérés. Une exigence de redevabilité qui contraint les États bénéficiaires et bailleurs à placer systématiquement la qualité de l’emploi au cœur des politiques, et légitime la demande citoyenne de transparence sur l’impact concret des fonds publics.
Si les réussites locales prouvent la possibilité de transformations rapides – réduction de pauvreté en Zambie, boom numérique en Guinée-Bissau, création d’emplois sanitaires au Maroc, investissements post-assainissement budgétaire à Madagascar, effet multiplicateur énergétique en Côte d’Ivoire –, l’article de la Banque Mondiale rappelle crûment l’ampleur des défis persistants: «des millions de ménages pauvres hors de portée des filets sociaux, trop d’enfants quittent l’école sans compétences de base, 56 pays avec des recettes fiscales inférieures à 15% du PIB, et des inégalités criantes dans l’accès aux infrastructures et au numérique». Des lacunes qui exigent des acteurs une mobilisation prioritaire sur trois fronts :
Fondamentalement, le capital humain (santé, éducation, compétences) se confirme comme socle non substituable. Sans investissements massifs dans ces domaines, les autres leviers – infrastructures, numérique, secteur privé – ne peuvent générer des emplois productifs ou permettre l’adoption des technologies vertes et digitales.
Enfin, l’impératif de réformes structurelles et de mobilisation du capital privé devient incontournable, comme le prouvent les modèles ivoiriens (IFC/MIGA dans l’énergie), bissau-guinéens (réformes télécoms) ou ukrainiens cités en référence. Ainsi, la régulation des télécoms, la modernisation fiscale et la gestion efficiente de la dette sont des catalyseurs indispensables pour atteindre l’échelle nécessaire, particulièrement pour la reconstruction et la transition verte, où le défi à venir consiste à mobiliser des capitaux privés bien plus importants. Une synergie public-privé qui s’impose comme le seul vecteur capable de transformer les réussites ponctuelles en dynamiques continentales pérennes.
Ainsi, l’on s’aperçoit que le tableau de bord de la Banque Mondiale n’est pas qu’un outil de reporting. Il vise à forger un réflexe du résultat: l’instinct qui nous pousse à nous soucier des résultats dans chaque décision, et non lorsqu’il est trop tard pour changer de cap. Pour les économies africaines et leurs acteurs – gouvernements, secteur privé local et international, institutions financières, société civile, citoyens – les leçons de la Zambie, du Maroc, de Madagascar, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée-Bissau sont claires: des interventions ciblées et des réformes courageuses dans des secteurs clés peuvent générer des impacts rapides et concrets sur l’emploi et les moyens de subsistance.
La vraie transformation réside dans l’adoption systématique de cette question par tous: «Comment cela se traduit-il en termes de moyens de subsistance ?». C’est cette exigence de résultats tangibles sur la vie des gens et la création d’emplois décents qui doit devenir l’état d’esprit dominant dans la conception et la mise en œuvre des politiques et investissements pour l’Afrique, souligne la BM. Les progrès sont réels mais fragmentaires ; les défis, immenses mais pas insurmontables. La voie est tracée: mesurer rigoureusement, agir de manière intégrée sur les multiples leviers, et placer l’emploi et la dignité au centre de chaque décision. Le travail, comme le dit si justement Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale, n’est pas fait sans emplois.
Nouveau paradigme de mesure d’impact de la Banque mondiale: les leçons de ces 5 pays d’Afrique
| Pays | Secteurs clés intervenants | Intervention principale / Réforme | Impacts concrets et résultats |
|---|---|---|---|
| Zambie | Développement rural, Protection sociale, Entrepreneuriat féminin | Filets de sécurité sociaux « transformateurs » : petites subventions + formations professionnelles et mentorat pour les femmes rurales. | Réduction de 30% de l’extrême pauvreté ; Augmentation de 80% des bénéfices des micro-entreprises ; Progression de l’épargne de plus de 230%. |
| Maroc | Santé, Gouvernance, Emploi | Réforme de la couverture santé universelle et refonte de la gouvernance sanitaire. | Amélioration de l’accès aux soins ; Création d’emplois formels dans le secteur des soins (professionnels et personnel de soutien) ; Renforcement du capital humain. |
| Madagascar | Finances publiques, Dette, Infrastructures | Meilleure gestion de la dette pour dégager une marge de manœuvre budgétaire. | Financement d’investissements dans les infrastructures ; Création d’emplois dans le BTP et les services annexes ; Développement de moyens de subsistance. |
| Côte d’Ivoire | Énergie, Infrastructures, Compétitivité | Expansion du réseau électrique soutenue par l’IFC et la MIGA. | Création d’emplois dans la construction et la maintenance ; Accès fiable à l’électricité pour les industries, PME et ménages ; Stimulation de l’écosystème économique. |
| Guinée-Bissau | Numérique, Inclusion, Régulation | Réformes réglementaires pour le secteur des télécoms, soutenues par l’IDA, l’IFC et la MIGA. | Pénétration du numérique passée de 12% à 36% en 4 ans ; Émergence d’emplois numériques, de la finance mobile et des marchés en ligne ; Inclusion économique des zones rurales. |
Source: Banque Mondiale.