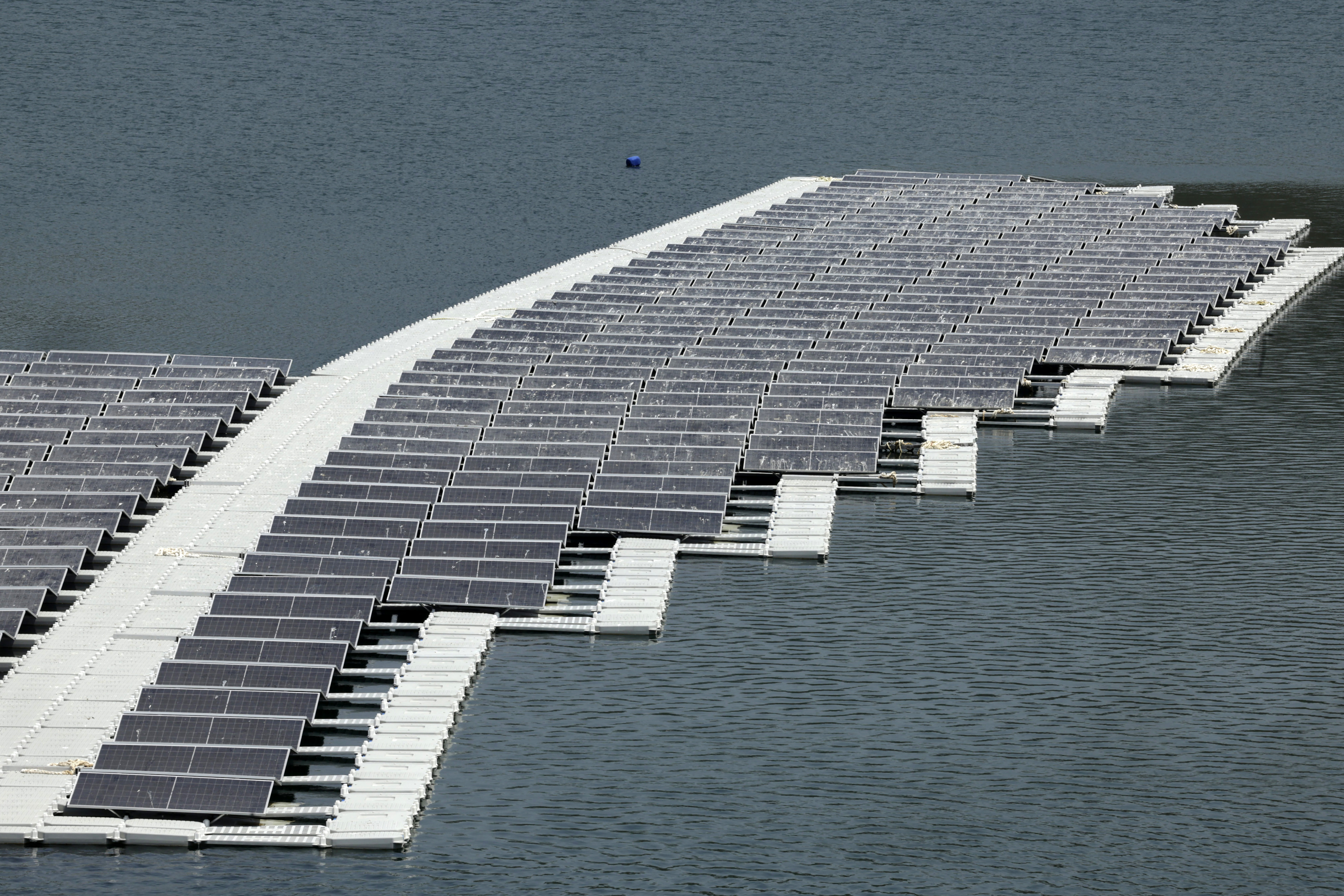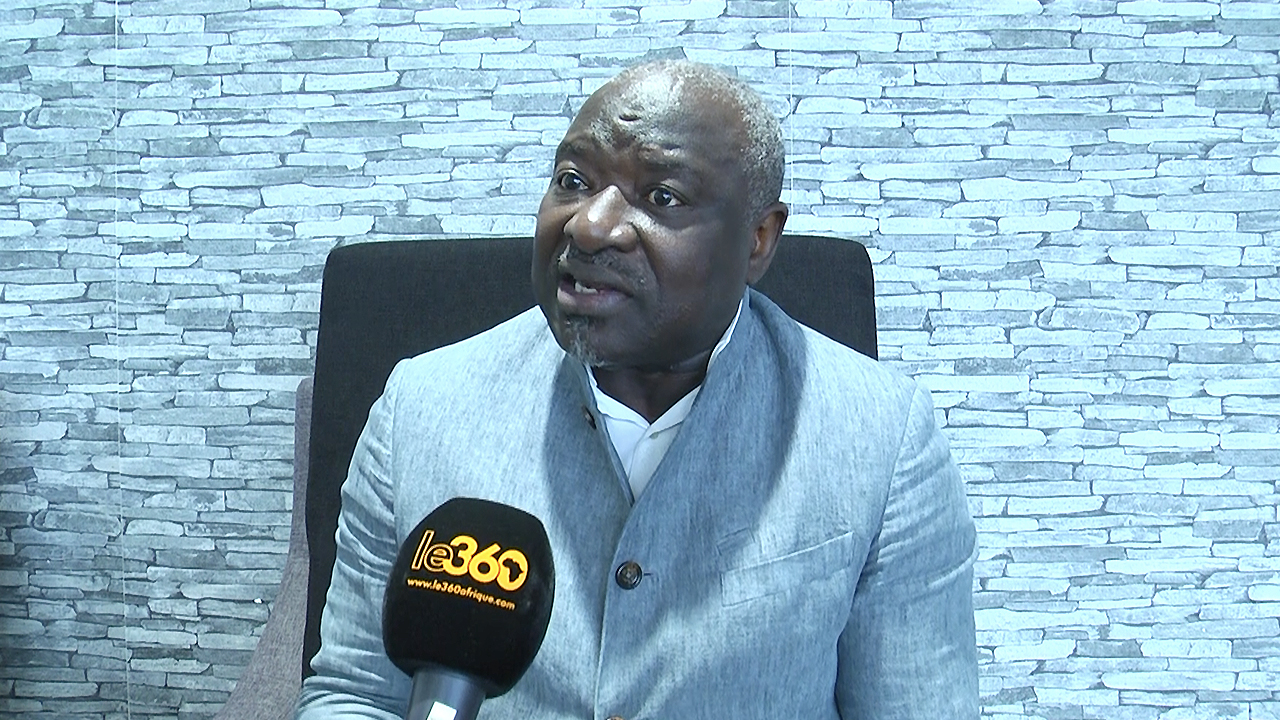Alors que sa demande énergétique croît, la Mauritanie opère une mue stratégique en signant un partenariat public-privé (PPP) structurant pour une centrale hybride, révélant une ambition qui conjugue souveraineté nationale et intégration régionale.
Le vendredi 12 septembre 2025, le ministre mauritanien de l’Économie et des finances, Sid’Ahmed Ould Bouh, et le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khaled, ont signé, à Nouakchott, un contrat de financement, de développement, de construction et d’exploitation d’une centrale de production d’énergie hybride fonctionnant à l’énergie solaire et éolienne d’une capacité de 60 MW, avec le directeur du groupe Ewa Green Energy, Moulay El Arby, pour environ 300 millions de dollars américains.
L’annonce de la construction d’une centrale hybride en Mauritanie va bien au-delà d’un simple fait d’actualité. Elle s’impose comme une pièce maîtresse dans la reconfiguration de l’architecture énergétique et géopolitique, tant pour la Mauritanie que pour l’ensemble de la région.
Au-delà des déclarations officielles, les implications concrètes méritent d’être analysées à travers les éléments techniques et contractuels déjà dévoilés.
Transformation structurelle du mix énergétique national
Concrètement, cet accord change la donne pour la Mauritanie sur plusieurs plans. Sur le plan technique, le pays s’équipe pour la première fois d’une centrale hybride intégrant un système de stockage par batteries. Une innovation cruciale qui permet de pallier l’intermittence des énergies renouvelables en injectant «jusqu’à 370 mégawatts/heure d’énergie stockée», notamment pendant la nuit ou lors des épisodes de faible ensoleillement. La capacité installée totale (220 MW) et la capacité garantie (60 MW) devraient assurer une fourniture quotidienne stable de 60 à 100 MW pendant 15 ans, renforçant significativement la sécurité d’approvisionnement de la SOMELEC.
Lire aussi : Mauritanie. 30 minutes d’électricité pour 5 heures de coupure: y a de quoi disjoncter
Un mécanisme qui transfère le risque de construction et de performance opérationnelle au privé. La SOMELEC, l’acheteur public, ne paiera que l’électricité effectivement livrée et conforme aux spécifications. De quoi éviter à l’État l’endettement direct et les dépassements de coûts initiaux. L’investissement de 300 millions de dollars est ainsi porté et managé par le partenaire privé, dont le retour sur investissement est conditionné par la performance réelle de l’infrastructure. Disons que l’on est ici face à un modèle qui aligne les intérêts. Le privé a tout intérêt à construire une centrale hautement performante et fiable pour maximiser ses revenus sur la durée du contrat.
D’un point de vue économique, la structure du PPP est révélatrice. La séparation entre le contrat de construction et le mécanisme d’achat de l’électricité transfère les risques techniques et opérationnels vers le privé, tandis que la puissance publique garantit un débouché stable. Un modèle attractif pour les investisseurs qui permet à la Mauritanie de mobiliser des capitaux privés pour des infrastructures stratégiques sans alourdir sa dette souveraine.
Une approche pragmatique et ambitieuse
Pour la Mauritanie, pays riche en ressources naturelles mais dont le système électrique reste vulnérable, ce projet est un saut stratégique. En diversifiant son mix énergétique via des ressources nationales (soleil, vent), le pays réduit sa dépendance aux importations de combustibles fossiles, améliorant sa balance commerciale et sa résilience face à la volatilité des prix des hydrocarbures. Ce qui renforce sa souveraineté énergétique.
Lire aussi : Signature à Nouakchott de l’accord d’interconnexion électrique entre le Maroc et la Mauritanie
Économiquement, une offre électrique plus stable, abondante et potentiellement moins chère à terme est un argument décisif pour attirer les investissements, notamment dans des secteurs miniers ou industriels énergivores. Cela crée un cercle vertueux pour le développement économique national. Ce type de projet, s’il est conduit avec des clauses sociales robustes et des dispositifs de formation adaptés, peut devenir un puissant vecteur de création d’emplois qualifiés et de transfert de compétences techniques. Il constituerait ainsi une opportunité stratégique pour renforcer l’employabilité et l’avenir professionnel de la jeunesse mauritanienne.
Les détails techniques communiqués – puissance installée, durée de construction fixée à douze mois et mise en service prévue pour septembre 2026 – traduisent à la fois la transparence de la communication et le degré d’avancement du projet. Ce calendrier resserré illustre par ailleurs une volonté politique affirmée de concrétiser rapidement cette infrastructure stratégique.
Le choix de garantir une fourniture quotidienne comprise entre 60 et 100 MW, et non l’intégralité de la capacité installée, traduit une approche pragmatique des énergies renouvelables. Les contractants ont manifestement intégré le facteur de charge réel – rapport entre la production effective et la capacité théorique maximale – afin de proposer une garantie crédible. Cette transparence technique constitue l’un des marqueurs d’un partenariat public-privé bien structuré, fondé sur des engagements réalistes et tenables.
Intégration énergétique régionale
La concomitance entre la signature de cet accord et la présence, le 8 septembre, de la ministre marocaine de la Transition énergétique, Leila Benali, à Nouakchott, lors de la séance d’ouverture de la 7ème Conférence Mauritanienne des Mines et de l’Energie (Mauritanides), n’est pas fortuite. Elle s’inscrit dans le cadre d’une «vision commune» entre les deux pays, comme le souligne la ministre. «Les deux pays partagent la même vision en ce qui concerne le développement du secteur de l’énergie, la diversification de ses sources et le renforcement de l’interconnexion électrique entre les deux pays».
C’est dans cette dynamique que le deal entre l’État mauritanien et le groupe Ewa Green Energy doit être analysé comme un maillon dans la construction d’un marché régional de l’énergie.
Comme le notent les organisateurs des Mauritanides, l’événement vise à «créer une plateforme régionale et internationale» et à «offrir aux investisseurs l’opportunité de nouer des partenariats». Ce PPP énergétique en est la concrétisation immédiate.
Lire aussi : Chantiers à l’arrêt à Nouakchott: «Les Mauritaniens refusent de travailler au même salaire que les Maliens»
La Mauritanie ne cherche plus seulement à satisfaire sa demande interne, mais positionne son immense potentiel renouvelable (solaire et éolien) comme un atout géoéconomique.
A cela s’ajoute le fait que le secteur extractif mauritanien, fortement énergivore, exige une alimentation électrique à la fois fiable et compétitive. La mise en place de cette centrale hybride, dotée d’un système de stockage, vise précisément à répondre à ces impératifs, tout en ouvrant la perspective d’excédents exportables vers le Maroc, voire au-delà.
En définitive, ce deal entre l’État mauritanien et le groupe Ewa Green Energy illustre une véritable montée en maturité stratégique. La Mauritanie mobilise intelligemment le levier des PPP pour accélérer sa transition énergétique tout en s’arrimant aux chaînes de valeur régionales. Ce PPP dépasse ainsi la seule dimension énergétique: il constitue un outil de politique économique et un vecteur de diplomatie régionale, positionnant la Mauritanie comme un acteur énergétique émergent sur l’échiquier régional.