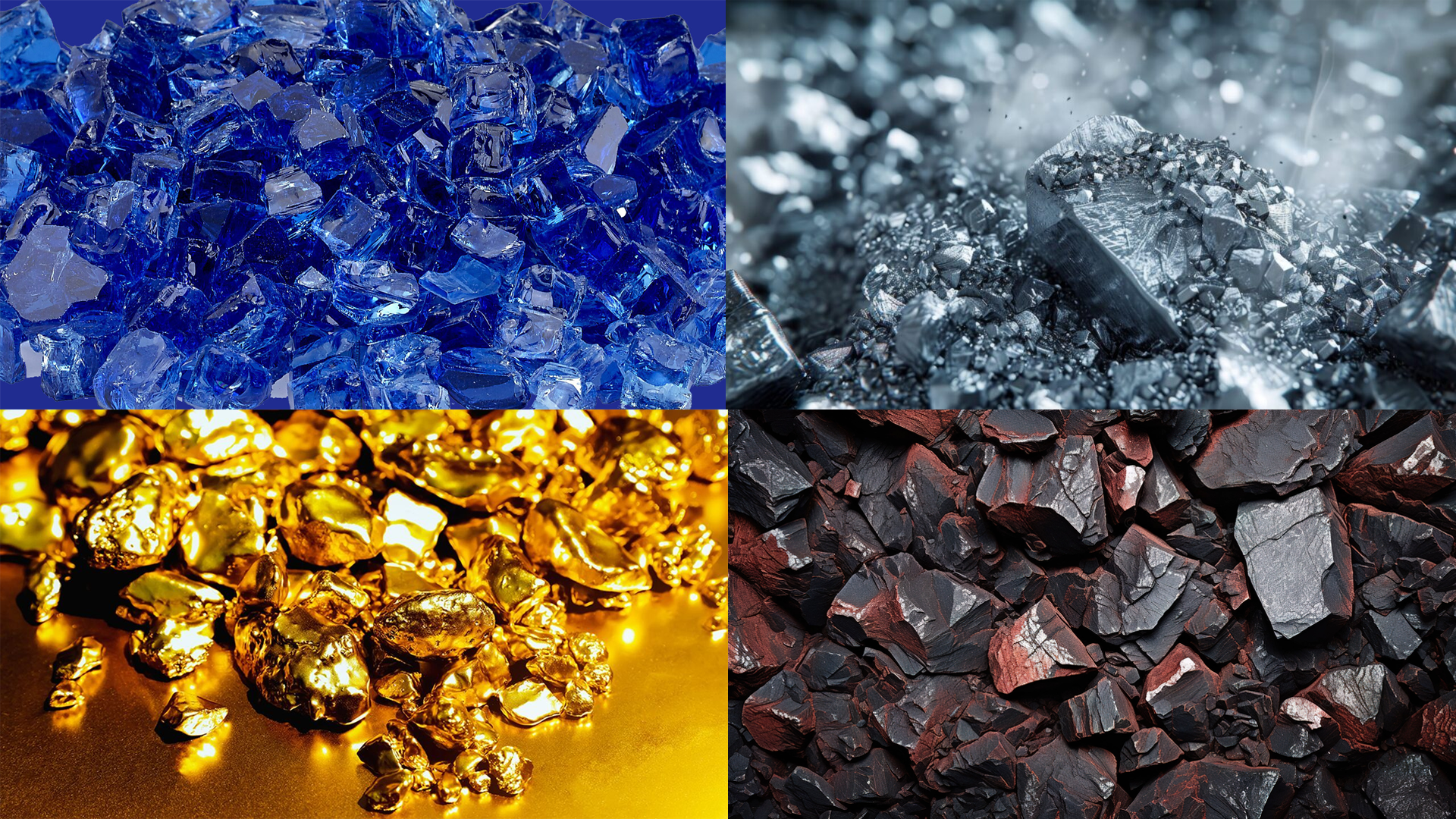Dans un contexte de course aux minerais critiques pour les énergies vertes et les nouvelles technologies, le Ghana devient un terrain de compétition entre blocs. Ce qui en fait un cas intéressant à analyser. La Chine y voit un maillon de ses Nouvelles Routes de la Soie; les États-Unis, un partenaire pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et l’Australie, un partenaire pour sécuriser ses investissements.
Lire aussi : Ghana: un excédent commercial de 5 milliards de dollars en 2024 dopé par les exportations d’or
Tiraillé entre ces blocs, le défi pour Accra est de concilier trois priorités contradictoires: éradiquer l’orpaillage illégal, qui est dévastateur sur le plan écologique, restaurer ses forêts, et industrialiser son secteur minier. La problématique est d’ailleurs la même dans bon nombre de pays de la région. Dans cette équation, les pressions socioéconomiques comme le chômage et la dépendance à l’extraction sont des variables à prendre en compte.
C’est dans ce contexte que le Ghana, acteur clé de l’économie minière ouest-africaine, se trouve au cœur d’un jeu diplomatique et économique impliquant trois puissances: la Chine, l’Australie et les États-Unis. Dans une dépêche que vient de publier la Ghana News Agency relayée par la MAP, l’on apprend que les ambassadeurs de ces pays ont rencontré Emmanuel Armah-Kofi Buah, ministre ghanéen des Terres et des Ressources naturelles, pour réaffirmer leur soutien aux politiques minières du gouvernement. Derrière les déclarations de coopération se cachent des enjeux complexes liés à la géopolitique des ressources, aux stratégies industrielles et aux défis de durabilité. Décryptons les propositions concrètes de chaque acteur et leurs implications pour le Ghana.
Le Ghana a annoncé investir dans la transformation locale pour accroître les revenus générés par le manganèse de 27 à 40%.. DR
La Chine capitalise sur son statut de créancier et d’investisseur
«Nous sommes prêts à nous aligner sur l’agenda du président Mahama. La Chine reste le plus grand investisseur au Ghana», fait savoir Tong Defa, ambassadeur de Chine, qui n’a pas manqué de souligner la relation «stratégique» entre les deux pays, rappelant les liens remontant à l’ère Nkrumah. La Chine, premier partenaire commercial du Ghana, propose un soutien dans la transformation structurelle de son économie, dans les initiatives environnementales, et les garanties juridiques.
Pékin entend accompagner le plan ghanéen de passage «d’une économie de production de matières premières à une économie de raffinage et de valeur ajoutée.» La relance de la fonderie d’aluminium VALCO, évoquée par le ministre ghanéen des Terres et des Ressources naturelles, pourrait bénéficier de capitaux et de technologies chinoises.
Lire aussi : Ghana: le nouveau président John Mahama prête serment
Sur le volet des initiatives environnementales, le ministre a présenté les programmes « Tree for Life » (reboisement) et «Blue Water» (gestion des ressources hydriques), perçus comme des niches pour les entreprises chinoises spécialisées dans les infrastructures vertes. Pour ce qui est des garanties juridiques, Emmanuel Armah-Kofi Buah a répondu aux préoccupations sur l’opacité des contrats miniers: «Les investisseurs chinois peuvent compter sur le cadre légal ghanéen pour prospérer», a assuré le ministre.
Comme l’on peut le constater, la Chine capitalise sur son statut de créancier et d’investisseur dominant en Afrique pour consolider son emprise sur les chaînes de valeur minières. Ainsi, son offre combine soft power (héritage Nkrumah) et hard power (infrastructures). Toutefois, ce modèle soulève des questions sur la dette environnementale et la dépendance technologique.
L’Australie mise sur son expertise technique
L’Australie, dont les entreprises dominent l’exploitation aurifère au Ghana, adopte une approche technique. La haute-commissaire Berenice Owen-Jones promet un soutien logistique et humain et un transfert de Compétences. Le soutien logistique et humain vise à renforcer la lutte contre le «fléau» de l’orpaillage illégal, qui détruit les écosystèmes et prive l’État de revenus. «Nous fournirons personnel et équipements pour aider le Ghana à naviguer à travers le fléau de l’exploitation minière illégale à petite échelle», a assuré Berenice Owen-Jones. Pour ce qui est du transfert de Compétences, l’Australie, leader mondial en technologies minières, pourrait former des experts locaux et contribuer à la modernisation des pratiques d’extraction.
Lire aussi : Discours sur l’état du Ghana : Akufo-Addo fait le point dans son discours d’au-revoir
Pour sa part, l’Australie mise sur son savoir-faire pour renforcer sa légitimité dans un secteur où elle est déjà implantée. Son engagement contre l’orpaillage clandestin répond aux critiques sur les impacts sociaux des multinationales, tout en sécurisant ses propres investissements.
Les États-Unis jouent la carte de la durabilité
L’ambassadrice américaine Virginia Palmer a axé ses déclarations sur la gestion forestière durable, notamment l’appui aux programmes comme «Women in Afforestation», qui intègrent genre et environnement ; et la gouvernance transparente. «Nous discuterons des moyens d’approfondir la coopération bilatérale, notamment dans la gestion des forêts», fait savoir l’ambassadrice américaine.
En matière de Gouvernance transparente, les États-Unis promeuvent une réforme du cadre minier ghanéen en s’appuyant sur l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE), norme mondiale exigeant la publication des revenus et contrats miniers. Ce mécanisme vise à renforcer la redevabilité, en associant gouvernement, entreprises et société civile à l’audit des flux financiers. En soutenant l’ITIE, Washington encourage Accra à lutter contre la corruption, à optimiser la fiscalité minière et à garantir que les ressources profitent aux populations. Cette approche, alignée sur les standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, contraste avec le modèle chinois, souvent critiqué pour son opacité, et renforce l’image des États-Unis comme défenseur d’une exploitation éthique.
Ainsi, les États-Unis jouent la carte de la durabilité et de l’éthique, contrepoids à l’influence chinoise. Leur focus sur l’inclusion sociale (femmes, communautés locales) s’inscrit dans une stratégie de diplomatie publique, visant à restaurer leur image après des années de désengagement relatif en Afrique.
Comment éviter la «malédiction des ressources»
Le Ghana cherche à maximiser les retombées de son or, bauxite et manganèse, tout en évitant la «malédiction des ressources». Et comme l’on peut le constater, les propositions des trois pays reflètent trois modèles économiques différents: l’intégration verticale de la mine à la transformation (Chine), l’optimisation technologique (Australie), ainsi que la certification éthique et la diversification sociale (États-Unis).
Lire aussi : Transformation locale de minerais: le Ghana passe du vœu pieux à l’action
Si la Chine se positionne sur le financement des infrastructures clés, à l’exemple de la fonderie d’aluminium VALCO, elle pourrait exiger des contreparties en accès aux ressources. L’Australie et les États-Unis, moins présents en capitaux, misent sur leur expertise pour garder une influence. Les offres de la Chine, de l’Australie et des États-Unis révèlent une bataille silencieuse. Si Pékin mise sur des investissements massifs et une intégration industrielle, Canberra et Washington privilégient des niches technologiques et éthiques.
Pour le Ghana, l’enjeu est de négocier ces partenariats sans compromettre sa souveraineté, en veillant à ce que l’exploitation minière profite réellement à son développement socio-économique. La réussite du Ghana, et des autres pays africains qui s’en inspireront, sur cet échiquier de la géopolitique des matières passera par un cadre juridique robuste, une gouvernance anti-corruption et une diversification stratégique des alliances.
Tout dépendra de la capacité des pays africains à imposer des clauses contraignantes. L’imposition de quotas d’emplois locaux pourrait canaliser la main-d’œuvre informelle vers des filières légales, tandis que des normes ESG (ensemble de facteurs et de normes utilisés pour évaluer les pratiques et la performance des entreprises en matière de développement durable et de responsabilité sociale) à l’exemple d’audits environnementaux, de partage des bénéfices conditionneraient les investissements étrangers à des pratiques durables. Cependant, cela nécessite un cadre réglementaire strict et un suivi indépendant, pour éviter le greenwashing ou les accords déséquilibrés.
Lire aussi : Les cours des minerais fluctuent: fortunes et infortunes des producteurs africains
La clé réside dans des partenariats public-privé transparents où technologies étrangères et priorités locales convergent. Cela dit, plusieurs questions restent posées: les quotas locaux suffiront-ils à absorber le chômage sans nuire à la compétitivité? Comment éviter que les partenariats ne reproduisent les déséquilibres postcoloniaux? Jusqu’où les pays africains pourront-ils résister aux pressions géopolitiques pour prioriser leurs propres intérêts?