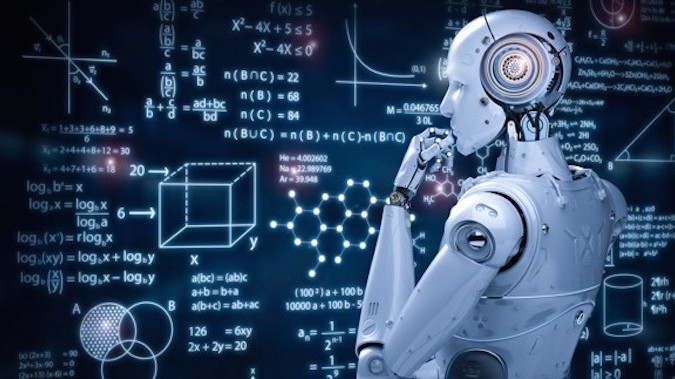40 milliards FCFA (environ 60,9 millions d’euros), 5 ans, 1.000 brevets... le partenariat entre l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et le Fonds africain de garantie (African Guarantee Fund, AGF) concerne les 17 pays africains membres de l’OAPI d’ici 2030 dont le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Ce mécanisme, fruit de cinq ans de préparation, vise à combler les lacunes structurelles du financement de l’innovation en Afrique, alors que le continent ne représente que seulement 4,11 % des brevets enregistrés auprès l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
C’est le lieu de souligner que ce chiffre révèle une tendance inquiétante: entre décembre 2024 et mai 2025, la part africaine est passée de 4,20 % à 4,11 % du total des brevets enregistrés auprès l’OMPI. En effet, à la date du 9 mai 2025, l’ensemble des pays africains réunis continue de stagner à 210.404 brevets, sur un total de 5.118.017 cette fois-ci. Une érosion qui, même minime, souligne l’urgence d’agir pour inverser la dynamique.
Lire aussi : L’Afrique ne représente que 4,20% des 5 millions de demandes de brevets déposées en un demi-siècle
Soulignons également que les 4,11 % actuels masquent une concentration extrême: cinq pays (Afrique du Sud, Maroc, Égypte, Tunisie, Kenya) captent à eux seuls 97,78 % des brevets africains.
Le dispositif OAPI-AGF cible donc explicitement les 17 États membres de l’organisation, souvent absents des radars de l’innovation mondiale, en misant sur la valorisation des brevets comme levier de développement. L’enjeu n’est pas seulement quantitatif, mais qualitatif: transformer des inventions locales en solutions industrielles.
Zoom sur cet accord, qui promet de transformer l’écosystème en valorisant les inventions en connectant les innovateurs aux industries et en accélérant la commercialisation des technologies.
Jules Ngankam, directeur général du Fonds africain de garantie (AGF), au pupitre.. DR.
Les deux leviers financiers stratégiques du partenariat
Le dispositif s’articule autour de deux leviers financiers stratégiques. D’une part, une prise de participation de 5 milliards FCFA (environ 7,622 millions d’euros) de l’OAPI dans le capital de l’AGF consolide l’alliance institutionnelle entre les deux entités, permettant une mutualisation des risques et une coordination renforcée. D’autre part, une fenêtre de garantie dédiée couvre jusqu’à 75 % des risques des prêts bancaires accordés aux PME innovantes et détentrices de brevets, réduisant ainsi les réticences des institutions financières à financer des projets perçus comme risqués.
Ce volet financier est complété par un accompagnement technique transversal, déployé à chaque phase du cycle de vie des projets. Cet accompagnement inclut l’audit des modèles économiques pour en garantir la viabilité, l’accès à des experts en propriété intellectuelle chargés d’optimiser la gestion et la défense des brevets, ainsi qu’un suivi personnalisé assuré par des mentors issus de secteurs clés tels que l’énergie, la santé ou l’agro-industrie.
Comme le souligne Denis Bohoussou, Directeur général de l’OAPI, «ce partenariat comble un vide structurel en offrant un appui concret, durable et à grande échelle», combinant ainsi outils financiers et expertise opérationnelle pour maximiser l’impact des innovations soutenues.
Repérage des innovateurs: critères et synergies régionales
La sélection des 1.000 projets s’appuiera sur un processus initié par des appels à candidatures dès le troisième trimestre 2025, ciblant prioritairement les porteurs de brevets enregistrés auprès de l’OAPI ou détenteurs de titres de propriété industrielle. Ces critères visent à garantir l’originalité des solutions et leur potentiel commercial, tout en favorisant leur alignement sur les Objectifs de développement durable (ODD), notamment l’ODD 7 relatif à l’énergie propre.
La faisabilité technique des projets sera évaluée par des comités d’experts indépendants, incluant des représentants du cabinet Deloitte, qui a piloté les études préparatoires. L’OAPI jouera un rôle pivot dans ce processus grâce à sa base de données centralisée des brevets déposés dans ses 17 États membres, offrant une cartographie inédite des innovations locales. Comme l’explique Denis Bohoussou, «les brevets sont une mine d’or sous-exploitée: ils révèlent des solutions locales adaptées aux défis africains». Cette approche systémique permet non seulement d’identifier les projets les plus prometteurs, mais aussi de créer des synergies régionales en connectant des innovateurs de pays aux écosystèmes complémentaires, tels que le Bénin et le Sénégal dans le domaine des biotechnologies ou le Cameroun et la Côte d’Ivoire dans l’agro-transformation.
Connecter les innovateurs aux industries : le rôle clé des PPP
Le mécanisme intègre une plateforme de mise en relation conçue pour rapprocher les innovateurs des acteurs industriels via trois canaux stratégiques. Premièrement, les réseaux de l’AGF, qui s’appuient sur un écosystème de 250 institutions financières et des partenaires de poids comme la Banque Africaine de Développement (BAD), facilitent l’accès à des financements structurés et à des opportunités de co-investissement.
Lire aussi : L’Afrique en 2025-2026: ces 9 pays devraient enregistrer des taux de croissance supérieurs à 6%, selon le FMI
Deuxièmement, des clusters sectoriels, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, permettent de capitaliser sur des succès antérieurs tels que la centrale solaire de 40 MW à Madagascar financée via la Mission 300, un projet phare illustrant la capacité de l’AGF à mobiliser des capitaux pour des infrastructures critiques.
Troisièmement, les foires technologiques organisées par l’OAPI servent de vitrines pour exposer les innovations brevetées, attirant des investisseurs et des acheteurs industriels régionaux. Par exemple, une PME ivoirienne spécialisée dans les systèmes d’irrigation économe en eau pourrait être connectée à un fabricant sénégalais de matériel agricole, grâce à l’intermédiation de l’AGF et aux garanties financières sécurisant la transaction. Une approche multi-niveaux qui transforme les brevets en ponts commerciaux, reliant l’ingéniosité locale aux chaînes de valeur continentales.
Valorisation des brevets: de la protection à la commercialisation
Avec seulement 2,22 % des brevets africains déposés via l’Organisation Régionale Africaine de la Propriété Intellectuelle (ARIPO) ou l’OAPI, le dispositif corrige ce déficit en instaurant des incitations tangibles pour transformer les titres de propriété intellectuelle en actifs économiques. Les prêts garantis sont conditionnés à l’exploitation commerciale des brevets, obligeant les bénéficiaires à intégrer leurs inventions dans des modèles d’affaires viables.
Lire aussi : Or artisanal: et si la Côte d’Ivoire s’inspirait du régulateur unique ghanéen
Parallèlement, l’OAPI fournit un appui juridique pour structurer des contrats de licence équitables, évitant aux innovateurs de céder leurs droits à vil prix face à des multinationales. Enfin, la création de fonds de royalties permet de réinvestir une partie des revenus générés par les brevets dans de nouveaux projets, établissant un cycle vertueux d’innovation. Comme le précise Jules Ngankam, Directeur général de l’AGF, « les brevets ne doivent pas dormir dans des tiroirs. Notre rôle est d’en faire des leviers de croissance ». Cette logique de valorisation agressive s’inspire de modèles éprouvés en Asie, où la monétisation des brevets a propulsé des économies entières, et vise à positionner l’Afrique comme un acteur de l’économie de la connaissance plutôt que comme un simple fournisseur de matières premières.
Un catalyseur pour l’économie de la connaissance
Malgré son ambition, le mécanisme se heurte à des défis structurels profonds. Les asymétries de compétences persistent, avec 97,78 % des brevets africains concentrés dans cinq pays (Afrique du Sud, Maroc, Égypte, Tunisie, Kenya), reflétant un déséquilibre régional dans les capacités d’innovation.
Par ailleurs, la dépendance aux devises étrangères impose un recours accru à des garanties en monnaie locale, comme le démontre la Mission 300 de l’AGF dans le secteur énergétique, pour neutraliser les risques de change et sécuriser les investissements.
Néanmoins, les impacts escomptés d’ici 2030 sont significatifs. Sur le plan économique, ce modèle s’apparente à un capitalisme de plateforme, où l’OAPI et l’AGF jouent le rôle d’intermédiaires de confiance, fluidifiant les échanges entre innovateurs, industriels et investisseurs tout en réduisant les coûts de transaction.
Une approche qui pourrait catalyser une transition vers une économie de la connaissance, où la propriété intellectuelle devient un pivot de la compétitivité africaine, à l’image de la Corée du Sud dont le décollage économique a été porté par une stratégie agressive de brevetage.
60 millions d’euros pour convertir 1.000 brevets en moteurs économiques d’ici 2030
| Points clés | Détails |
|---|---|
| Objectifs | Financer 1.000 projets innovants dans 17 pays africains d’ici 2030 ; valoriser les brevets pour stimuler une économie de la connaissance. |
| Chiffres clés | - 60,9 millions d’euros investis. - 4,11% des brevets mondiaux détenus par l’Afrique (97,78% concentrés dans 5 pays). - 75 % de garantie sur les prêts aux PME innovantes. |
| Mécanismes | - Prise de participation de l’OAPI dans l’AGF. - Garanties financières et accompagnement technique (audits, mentors, expertise en PI). - Plateforme de mise en relation innovateurs/industries. |
| Cibles | PME détentrices de brevets dans les 17 États membres de l’OAPI (Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire...), priorités sur les ODD (énergie propre). |
| Défis | - Concentration des brevets dans 5 pays (Afrique du Sud, Maroc, Égypte, Tunisie, Kenya). - Dépendance aux devises étrangères. - Faible exploitation commerciale des brevets. |
| Impacts attendus | - Transition vers une économie de la connaissance. - Création de synergies régionales. - Modèle inspiré de la Corée du Sud (brevets comme leviers économiques). |
Source : OAPI.