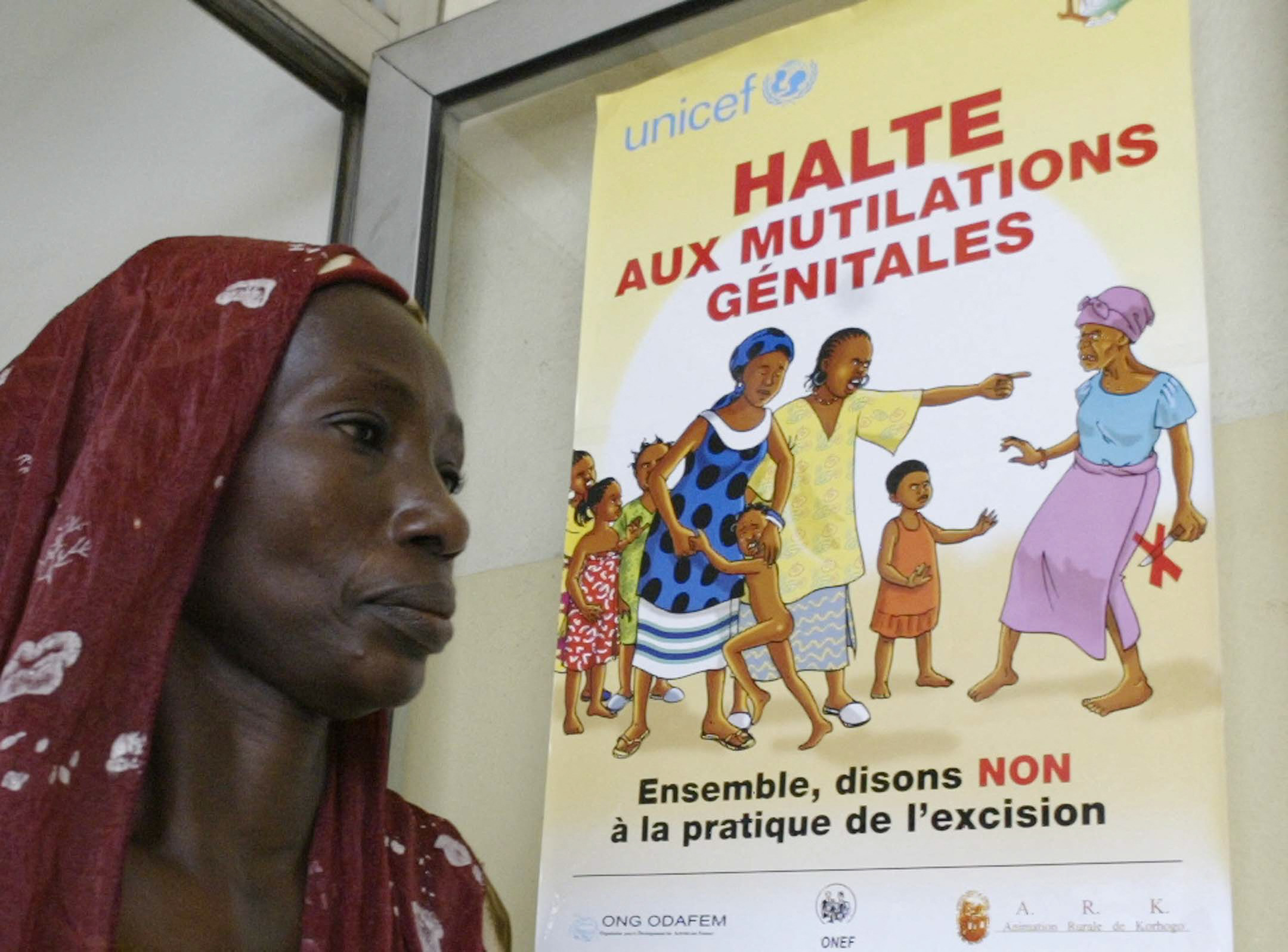«L’industrie des boissons et aliments ultra-transformés use de son pouvoir et de son influence considérable pour déjouer les mesures des gouvernements et s’opposer à tout changement de politique significatif», alerte le dernier rapport de l’UNICEF intitulé "Alimenter les profits: comment les environnements alimentaires compromettent l’avenir des enfants».
Il y a surpoids, selon l’Organisation mondiale de la Santé quand l’Indice de la Masse Corporelle (IMC) est égal ou supérieur à 25 et obésité quand l’IMC est égal ou supérieur à 30. L’IMC se calcule en divisant le poids (en kilogrammes) par le carré de la taille (en mètres).
C’est dans ce contexte que le rapport dresse un constat sans appel. La malnutrition sous sa forme de surpoids et d’obésité est devenue une pandémie mondiale, y compris sur le continent africain. Pour la première fois, l’obésité a dépassé l’insuffisance pondérale chez les enfants d’âge scolaire et les adolescents à l’échelle mondiale, révèle le rapport.
Ainsi, l’analyse du Top 10 des pays africains ayant le plus d’enfants de moins de 5 ans en surpoids révèle des tendances profondément inquiétantes et soulève des questions.
Boissons sucrées. L'infiltration des environnements scolaires par la malbouffe est un facteur clé de la stagnation alarmante du surpoids dans plusieurs pays du Top 10. . DR
Une hétérogénéité alarmante
Le classement présenté par l’Unicef montre une prévalence du surpoids chez les moins de 5 ans qui fluctue de 18% en Tunisie à 8% au Cap-Vert, en Guinée équatoriale et au Lesotho, pour ne parler que des pays du Top 10. Plus en détails, le classement présenté par l’UNICEF révèle une situation particulièrement alarmante en Tunisie, qui caracole en tête avec un taux de surpoids infantile de 18%, en nette augmentation depuis 2012 (14%).
Le Cameroun suit avec 14% contre 8% en 2012, affichant la plus forte dégradation avec une progression défavorable très marquée. L’Algérie et l’Afrique du Sud se partagent la troisième place avec 13%, mais avec des trajectoires différentes. L’on note une stabilité préoccupante pour l’Afrique du Sud et une légère amélioration insuffisante pour l’Algérie.
Lire aussi : Cap Vert & Sierra Leone : le Parlement de l’Enfant du Maroc fait des émules
La tendance la plus frappante qui se dégage de ce palmarès négatif est l’absence quasi-générale de progrès. Seule l’Égypte (6ème ex-aequo) montre une amélioration notable, étant passée de 15% à 11% entre 2012 et 2024. Tous les autres pays stagnent ou voient leur situation s’aggraver. La majorité (7 pays) n’enregistre «aucun progrès» et trois (Tunisie, Cameroun, Cabo Verde) voient leur situation «s’aggraver», selon l’Unice. Cela indique une absence généralisée de politiques efficaces pour inverser la courbe.
Le Botswana (5ème), les Seychelles (6ème ex-aequo avec l’Égypte), l’Eswatini (8ème), la Guinée équatoriale et le Lesotho- tous deux 9ème ex-equo- présentent une prévalence stable mais élevée, tandis que le Cap-Vert -9ème ex-aequo- rejoint le Cameroun dans la catégorie des pays où la situation nutritionnelle se détériore. Cette uniformité dans l’absence de progrès souligne l’urgence d’une réponse coordonnée à l’échelle continentale face à l’envahissement des environnements alimentaires par les produits ultra-transformés.
Plusieurs constats s’imposent. Commençons par la présence de pays à revenu intermédiaire comme la Tunisie, l’Afrique du Sud, l’Algérie ou le Botswana en tête de liste. Ce qui corrobore l’analyse du rapport. «A mesure que les pays s’enrichissent, les boissons et aliments ultra-transformés deviennent plus accessibles et abordables, conduisant à une augmentation du surpoids dans toutes les couches sociales».
L’autre constat est que le problème n’épargne pas l’Afrique. La moyenne en Afrique subsaharienne (4%) reste inférieure à la moyenne mondiale (5%), mais les chiffres de certains pays dépassent largement celle des États-Unis (10%) pourtant réputé. Aussi, la moyenne du Moyen-Orient et Afrique du Nord (8%) interpelle. La Tunisie (18%) et le Cameroun (14%) affichent des taux catastrophiques, signant l’importation d’un modèle alimentaire occidental délétère.
L’absence du Maroc
Le fait que le Maroc (4% en 2024 contre 10% en 2012) n’apparaisse pas dans ce Top 10 est, en soi, à souligner. Une hypothèse peut l’expliquer : un stade différent de transition nutritionnelle. En effet, le Maroc, bien qu’en développement, pourrait ne pas avoir encore atteint le niveau de pénétration massive des produits ultra-transformés observé dans les pays en tête du classement. Son modèle alimentaire traditionnel, centré sur les céréales, les légumineuses et les fruits et légumes, pourrait encore jouer un rôle protecteur – bien que fragilisé. Mieux, le Royaume montre une amélioration notable, étant passée de 10% à 4% entre 2012 et 2024.
Lire aussi : Mauritanie: la malnutrition, un problème de santé publique
Il y a aussi le volet fiscal à ne pas négliger. Rappelons que le Maroc taxe les boissons sucrées depuis la loi de finances 2019. Cette loi a introduit une augmentation de 50% de la taxe intérieure sur la consommation (TIC) applicable aux boissons gazeuses ou non contenant du sucre. En plus, d’une TVA spécifique.
En 2024, le pays a renforcé la taxation des boissons sucrées, puis accentuée en 2025. Une stratégie fiscale comportementale visant explicitement à réduire la consommation de sucre en augmentant les prix et en incitant les industriels à reformuler leurs produits. Une mesure courageuse, alignée sur les recommandations de l’OMS, qui constitue un levier puissant pour protéger les environnements alimentaires.
De telles mesures semblent avoir contribué, avec la résilience du modèle alimentaire traditionnel, à l’amélioration notable observée, faisant du Maroc un cas d’étude prometteur en matière de politique publique nutritionnelle sur le continent.
Quelle que soit la raison, cette absence ne doit en aucun cas être interprétée comme une raison de se satisfaire. Au contraire, elle doit servir d’avertissement et offrir une fenêtre d’opportunité pour agir de manière proactive et éviter de suivre la trajectoire désastreuse de la Tunisie ou du Cameroun.
Une crise mondiale aux visages multiples
À l’échelle mondiale, le phénomène prend une ampleur vertigineuse. Le Top 3 est dominé par l’Australie (26% en 2024 contre 14% en 2012), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (19% contre 12%) et les Îles Turques-et-Caïques, territoire britannique d’outre-mer situé dans l’océan Atlantique Nord, au sud-est des Bahamas, au nord-est de Cuba et au nord d’Haïti (18% contre 15%).
Lire aussi : La malbouffe gagne du terrain au Maroc
Ces pays et territoires, dont les taux dépassent de très loin la moyenne mondiale stagnante à 5%, illustrent la diversité des contextes touchés: nations développées, États insulaires du Pacifique et économies émergentes.
L’explosion du taux australien, qui a presque doublé en douze ans, est particulièrement édifiante. Elle démontre que même les pays aux systèmes de santé sophistiqués sont impuissants face à un environnement global caractérisé par l’omniprésence marketing et l’accessibilité des produits ultra-transformés.
Des leviers d’action
L’analyse de l’Unicef est claire. Le problème est systémique et nécessite une réponse tout aussi systémique. Le rapport identifie les coupables: la disponibilité, l’accessibilité financière et le marketing agressif des produits malsains.
Pour les pays du Top 10, les implications économiques sont colossales. Katherine Shats, une des auteurs du rapport, citée dans la dépêche AFP, le souligne. «Il est impossible d’échapper aux conséquences sur la santé de la malbouffe seulement par l’activité physique». La hausse prévisible des maladies non transmissibles (diabète, cancers, maladies cardiovasculaires) pèsera lourdement sur un système de santé déjà sous tension et amputera la productivité future de ces nations.
Lire aussi : Le célèbre tiktokeur Khaby Lame nommé ambassadeur par l’Unicef
Dans ce contexte, agir nécessitera une volonté politique ferme pour mettre en place un cadre réglementaire complet et cohérent, incluant entre autres, des restrictions du marketing alimentaire ciblant les enfants, surtout le marketing digital omniprésent et insidieux ; une fiscalité intelligente (taxe sur les boissons sucrées) pour rendre les options saines plus compétitives ; un étiquetage nutritionnel frontal compréhensible (comme le Nutri-Score).
Il est possible d’aller plus loin, notamment à travers la régulation des environnements alimentaires scolaires pour en faire des zones sans promotion de malbouffe ou encore la révision des subventions agricoles pour favoriser les filières d’aliments sains et frais.
Ainsi, le constat est clair. Les pays africains sont dans une course contre la montre dont l’enjeu n’est pas seulement nutritionnel, il est sociétal et économique. La fenêtre d’action se referme rapidement. Il est urgent d’agir avec une détermination sans faille pour ne pas se voir, dans un prochain rapport, figurer en tête de ce triste classement.
Obésité infantile: un Top 10 africain qui alerte
| Rang | Pays | Prévalence en 2024 | Données de 2012 | Progression | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisie | 18% | 14% | Détérioration | Situation la plus alarmante. Dégradation nette. |
| 2 | Cameroun | 14% | 8% | Détérioration | Dégradation la plus forte. Prévalence presque doublée. |
| 3 | Algérie | 13% | 14% | Aucun progrès | Légère amélioration mais stagnation dans les faits. |
| 3 | Afrique du Sud | 13% | 13% | Aucun progrès | Stabilité à un niveau très préoccupant. |
| 5 | Botswana | 12% | 11% | Aucun progrès | Stabilité à un niveau élevé. |
| 6 | Égypte | 11% | 15% | Progrès | Seul pays à montrer une amélioration notable. |
| 6 | Seychelles | 11% | 10% | Aucun progrès | Légère dégradation masquée par la stabilité du taux. |
| 8 | Eswatini | 10% | 10% | Aucun progrès | Stabilité à un niveau élevé. |
| 9 | Cabo Verde | 8% | 6% | Détérioration | Dégradation constante. |
| 9 | Guinée Équatoriale | 8% | 9% | Aucun progrès | Légère amélioration mais stagnation. |
| 9 | Lesotho | 8% | 7% | Aucun progrès | Légère dégradation. |
Source: UNICEF.