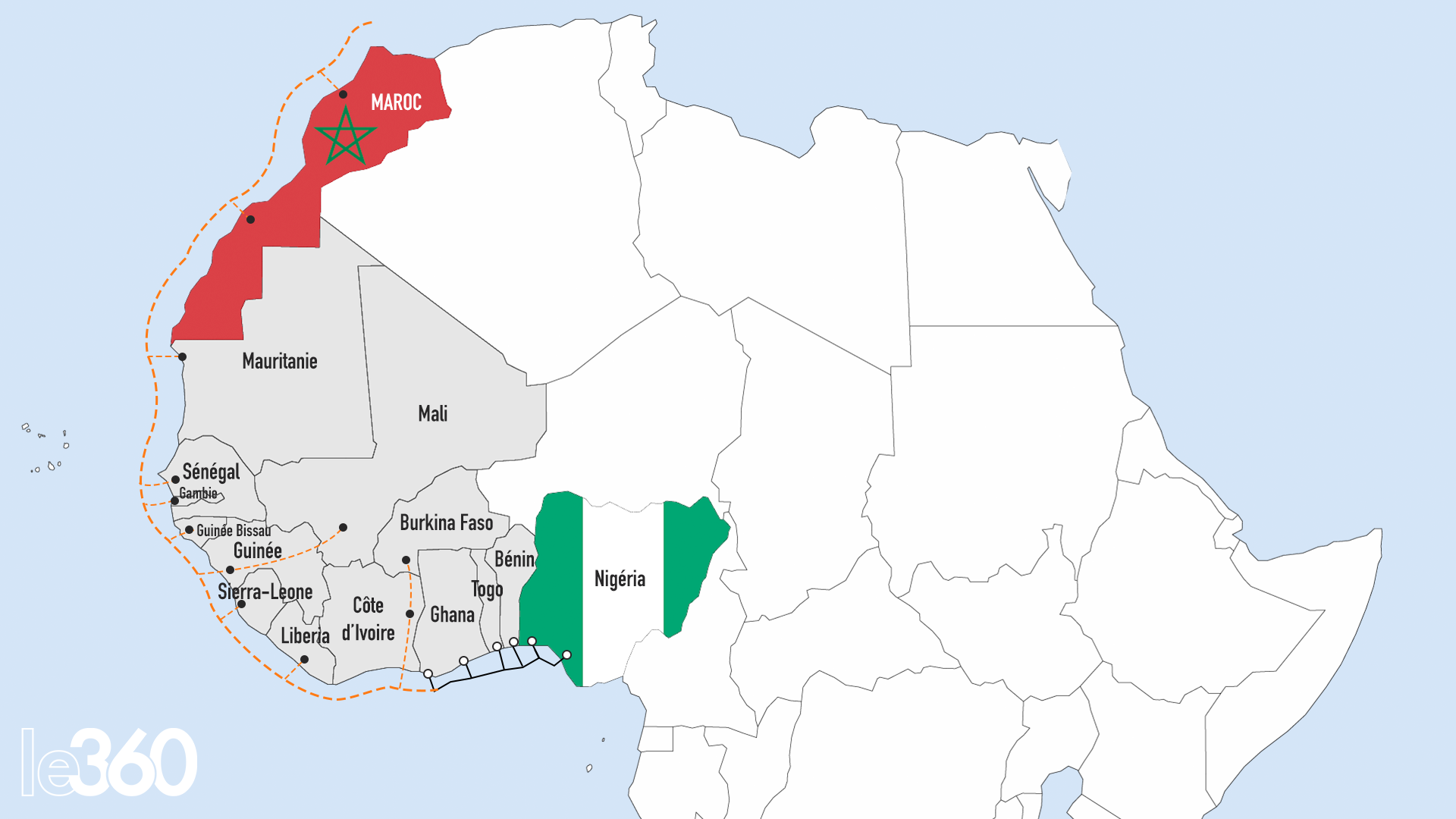En dépit de son impact négatif sur l’environnement en raisont des émissions de CO2, de la volonté de certains Etats d’éliminer le torchage à l’horizon 2030 et des retombées positives attendues de l’arrêt de cette pratique dont la récupération du gaz pour produire de l’électricité, les géants pétroliers mondiaux continuent de bruler le gaz naturel associé à l’extraction du pétrole.
Selon le rapport de suivi Global Gas Flaring Tracker 2025 de la Banque mondiale, le phénomène semble reprendre un trend haussier. En effet, en 2024, le volume mondial de gaz torché s’est établi à 151 milliards de mètres cubes, soit 3 milliards de plus que l’année précédente. C’est le volume le plus élevé enregistré depuis 2007. Un coup dur à l’initiative mondiale pour l’élimination du torchage de routine d’ici 2030 à laquelle de nombreux pays ont souscrit.
Pour rappel, lors de l’extraction du pétrole, du gaz et de l’eau peuvent remonter en surface. Une fois séparé de l’eau et du pétrole, le gaz naturel considéré comme un sous-produit, est brûlé sur site par des torchères, faute d’infrastructures de traitement (unité de liquéfaction, de compression, de purification…) ou de transport.
Les quantités de gaz étant généralement faibles, les géants pétroliers mondiaux préfèrent torcher ce gaz au lieu d’investir dans des infrastructures coûteuses et surtout peu ou pas rentables.
Lire aussi : Pétrole: le Nigeria maintient son rang de premier producteur de brut grâce à la lutte contre le siphonnage
Dans certains pays, le gaz brulé lors de l’extraction du pétrole est important. Au niveau mondial, selon le rapport de la Banque mondiale et son Fonds fiduciaire mondial pour la réduction du torchage et du méthane (Global Flaring and Methane Réduction trust fund -GFMR), en 2024, le volume de gaz torché a atteint 151 milliards de mètres cubes en 2024, soit l’équivalent de la consommation annuelle en gaz du continent africain. En valeur, la perte due au torchage est estimée à 63 milliards de dollars.
Si presque tous les pays producteurs de pétrole du monde participent au torchage du gaz, quelques-uns d’entre eux concentrent l’essentiel des gaz torchés au niveau de la planète. Leur part dans le torchage ne cesse de croitre. Ainsi, la part des neuf premiers pays torcheurs -Russie, Iran, Irak, Etats-Unis, Venezuela, Algérie, Libye, Mexique et Nigeria- est passée de 65% en 2012 à 76% en 2024. Ces neuf pays ne produisent qu’à peine 47% du brut mondial. La Russie est derrière plus de 28 milliards de mètres cubes de gaz torchés en 2024.
Lire aussi : Pétrole & gaz: même si les prix flambent, voici pourquoi les pays africains ne peuvent pas pleinement en profiter
Ainsi, l’Algérie, le Nigeria et la Libye se classent respectivement au 6e, 7e et 8e rang des plus grands torcheurs de gaz au monde avec un volume cumulé dépassant les 20 milliards de mètres cubes de gaz en 2024, soit une perte estimée à 8,5 milliards de dollars.
En Algérie, en 2024, le volume de torchage a diminué de 4% pour s’établir à environ 8 milliards de mètres cubes de gaz. Toutefois, cette baisse est essentiellement le fait de la baisse de la production du pays sous l’effet de l’épuisement des champs pétroliers. Celà représente une perte d’environ 3,4 milliards de dollars.
L'Algérie est le premier pays torcheur de gaz en Afrique avec un volume de gaz torché d'environ 8 milliards de mètres cubes. La perte est évaluée à environ 3,4 milliards de dollars.
En Libye, après une augmentation significative du torchage de 25% en 2023, celui-ci a baissé de 8% en 2024 pour s’établir autour de 6 milliards de mètres cubes. La baisse du volume de gaz torché dans ce pays s’explique uniquement par la fermeture de plusieurs grands champs pétroliers au second semestre de l’année dernière à cause de l’instabilité politique et aux manifestations, entrainant une réduction de la production pétrolière du pays.
Lire aussi : Le Nigeria va commercialiser le gaz torché qui fait perdre annuellement des milliards de dollars au pays
Pour le Nigeria, premier producteur de pétrole africain, après plusieurs années de réduction, le volume de gaz brulé a augmenté de 12% en 2024, alors que sa production pétrolière n’a augmenté que de 3%. Cette forte hausse, qui s’explique par l’augmentation de l’intensité du torchage -quantité de gaz torché par baril de pétrole produit- de 8%, est le fait essentiellement des installations pétrolières et gazières exploitées par la Nigerian national petroleum corporation (NNPC), la compagnie pétrolière d’Etat, et plusieurs petites entreprises locales qui ne sont pas dotées d’expertises et de financements nécessaires pour récupérer et utiliser le gaz torché.
Ces structures sont à l’origine de 60% du gaz torché en 2024 alors qu’elles représentent une proportion faible de la production pétrolière du pays dominée par les majors étrangères.
Le torchage a privé le Nigeria d’environ 6,5 milliards de mètres cubes de gaz en 2024. Sachant qu’à peine 60% de la population a accès à l’électricité, la récupération et l’orientation de ce gaz vers des centrales électrique permettrait de réduire considérablement le déficit énergétique du pays.
Lire aussi : Qui sont les 18 pays africains figurant parmi les 20 les moins électrifiés au monde?
Pour Demetrios Papathanasiou, directeur du pôle Énergie et industries extractives à la Banque mondiale, «il est extrêmement frustrant de constater le gaspillage de cette ressource naturelle, alors que plus d’un milliard de personnes n’ont toujours pas accès à une énergie fiable et que de nombreux pays cherchent de nouvelles sources d’énergie pour répondre à une demande croissante».
Face aux nombreuses conséquences néfastes du torchage, la Banque mondiale et les Nations unies ont lancé en avril 2015 l’initiative «Zéro torchage de routine d’ici 2030» visant à mettre fin à cette pratique. Depuis son lancement, 36 gouvernements et 60 compagnies pétrolières et gazières, représentant 60% du torchage mondial du gaz en 2024, ont adhéré à cette initiative.
Seulement, l’élimination du torchage a un coût. Selon l’institution de Breton-woods, l’élimination du torchage systématique nécessite environ 100 milliards de dollars d’investissement.
Reste que ce coût est largement compensé par les nombreux avantages. D’abord, cela se traduit par une hausse de la disponibilité du gaz via la récupération des quantités récupérées. Ensuite, la réduction du torchage entraine une baisse de l’impact environnemental. Le gaz torché cause une émission de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone et méthane) considérable, contribuant au réchauffement climatique de la planète. «On estime que 389 millions de tonnes d’équivalent CO₂, dont 46 millions provenant de méthane imbrûlé, l’un des plus puissants gaz à effet de serre, ont été rejetés en pure perte dans l’atmosphère», souligne la Banque mondiale.
En outre, en commercialisant le gaz récupéré, le pays peut en tirer une valeur économique substantielle. La Banque mondiale estime que la fin du torchage pourrait générer entre 19 et 63 milliards de dollars par an au profit des pays producteurs de pétrole.
Lire aussi : Gabon. Matériel vétuste, gestion inefficace, gabegie... la face obscure des délestages
Enfin, le torchage étant un gaspillage de ressources alors que de nombreux pays vivent une insécurité énergétique chronique, sa réduction pourrait favoriser la production d’électricité à partir gaz récupéré et réduire le déficit énergétique des pays africains producteurs de pétrole comme le Nigeria, l’Angola, le Congo, le Gabon…
Seulement, pour réduire le torchage, il faut, entre autres, avoir une véritable volonté politique, disposer des infrastructures nécessaires et adopter des règlementations qui interdisent cette pratique et forcer les multinationales à l’arrêter. Des pays comme la Colombie et Kazakhstan ont obtenu des résultats notables en adoptant des règlementation très strictes interdisant le torchage et la déperdition des gaz résiduels.