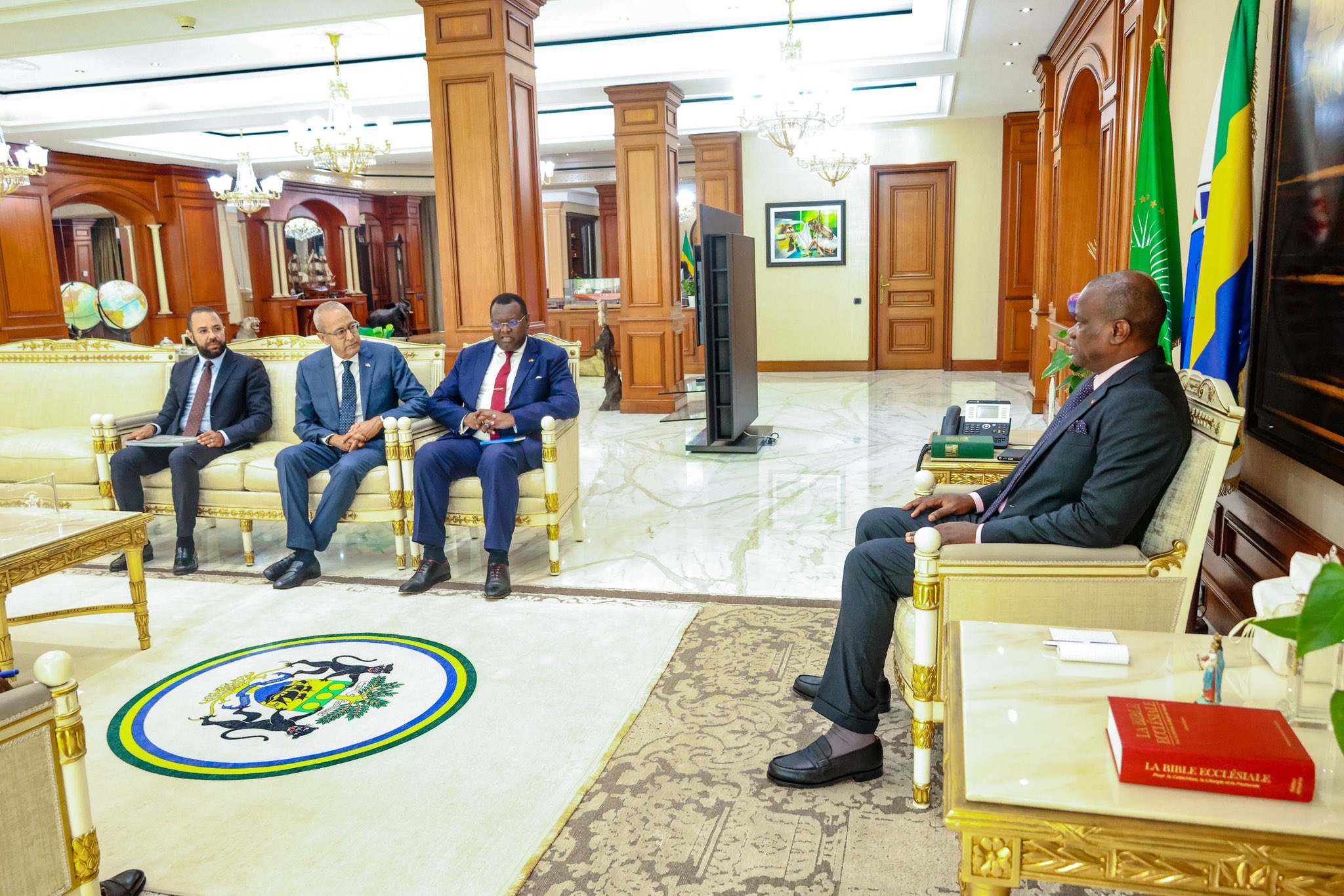À compter de la fin du mois de septembre, le paysage des stations-service et des sociétés de transport de produits pétroliers dits «blancs» (essence, diesel, etc.) devra changer de visage.
Par décret présidentiel, ces emplois, tout comme ceux de directeurs d’agences bancaires, jusqu’alors largement occupés par une main-d’œuvre expatriée, seront réservés aux nationaux. Une décision politique présentée comme une réponse au chômage endémique des jeunes, mais dont la mise en œuvre devra surmonter plusieurs écueils.
Dans la rue, la mesure est accueillie avec optimisme. Pour de nombreux Gabonais, elle représente une lueur d’espoir dans un contexte économique difficile.
Lire aussi : Gabon: la fonction publique ou le mythe de la réussite individuelle
Guy Pierre, employé du secteur privé, y voit une opportunité d’épanouissement pour toute une génération «cette décision va permettre à certains Gabonais de s’épanouir parce que le taux de chômage en milieu jeune est important.»
Un sentiment partagé par Mamadou Bekale, sans emploi, pour qui l’accès au travail est une question de stabilité sociale et de sécurité «nous jeunes Gabonais on cherche du travail. On en a vraiment besoin monsieur le président.»
Au-delà de la dimension sociale, les implications économiques sont significatives, comme le souligne Louis Paul Motass, analyste économique. Il salue une réforme qui, sur le papier, présente de solides avantages macroéconomiques. «Qui dit emplois d’expatriés dit transfert de capitaux vers l’étranger. La mesure va donc permettre de maintenir et d’absorber les revenus des nationaux.»
En clair, les salaires versés à des employés locaux seront en grande partie dépensés dans l’économie nationale, stimulant ainsi la consommation et la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). Selon les prévisions du ministre du Pétrole, près de 900 emplois pourraient être concernés à court terme.
Lire aussi : Gabon: les étrangers victimes de xénophobie?
Cependant, l’économiste émet un sérieux bémol, jetant une lumière crue sur le défi fondamental de cette politique: la question des compétences. Un décret suffit-il à créer les capacités humaines nécessaires? «Mais attention, comme dans le secteur bancaire, il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité des compétences locales. Dans le cas contraire, il va falloir en former pour limiter les dérapages», met en garde M. Motass.
Sans un vivier de talents nationaux suffisamment qualifiés, les entreprises concernées pourraient en effet faire face à une baisse de productivité ou à des risques opérationnels.
Face à ce défi, l’expert préconise non pas une application brutale, mais une stratégie graduelle. «Je propose donc une stratégie transitoire d’un à deux ans avant de tout nationaliser.»
Lire aussi : Maroc Telecom va-t-il perdre sa filiale gabonaise?
Cette période serait cruciale pour identifier les postes critiques, évaluer les besoins en formation et mettre en place des programmes de transfert de compétences avec les employés expatriés actuels, assurant ainsi une passation de savoir-faire sans heurts.
La décision de nationaliser certains emplois stratégiques au Gabon est, à n’en pas douter, une réponse audacieuse à une pression sociale croissante. Elle porte en elle la promesse d’une meilleure justice économique et d’un dynamisme accru pour l’économie nationale.
Pour autant, le chemin entre l’intention politique et la réalisation concrète est semé d’embûches. Le succès de cette politique ne se mesurera pas à l’aune du décret, mais à celle de sa mise en œuvre.
Cette volonté de nationaliser l’emploi dans les secteur bancaire et pétrolier n’est pas sans rappeler celui du transport urbain également majoritairement tenu par des expatriés du moins jusqu’en 2024, année du lacement du programme «Un Taxi, un emploi, un avenir» qui donne la priorité aux nationaux pour être chauffeur de taxi.